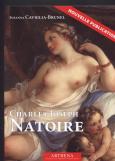 | Caviglia-Brunel, Susanna: Charles-Joseph Natoire. 24x32 cm, 582 p., 1281 ill. dont 154 en coul., ISBN : 978-2-903239-48-0, 109 € (offre valable jusqu’au 25 avril 2012, après cette date : 149 €)
(Arthena, Paris 2012)
|
Rezension von Christophe Henry Anzahl Wörter : 6371 Wörter Online publiziert am 2012-06-25 Zitat: Histara les comptes rendus (ISSN 2100-0700). Link: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1650
En avril 2012, les éditions Arthena ont mis à la disposition du public et des chercheurs un nouvel opus consacré au peintre Charles-Joseph Natoire (Nîmes 1700 - Castel Gandolfo 1777). Publié avec le concours du Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de l’art et musicologie (CRIHAM, EA 4270) et avec le soutien de la Fondation Auguste Morin, cette somme monumentale vient une fois de plus confirmer la vocation de l’association Arthena à diffuser certains des matériaux fondamentaux de la connaissance en histoire de l’art. Sans ces catalogues raisonnés et la relative assurance qu’ils procurent quant à l’ identité d’une œuvre, il serait en effet bien difficile de l’inscrire dans un contexte ou de l’interpréter.
Maître de conférences en histoire de l’art moderne et contemporain à l’université de Limoges, Susanna Caviglia-Brunel est une spécialiste de la peinture et du dessin en France et en Italie au XVIIIe siècle. Elle s’est particulièrement intéressée aux questions touchant à la peinture d’histoire du siècle des Lumières et aux usages artistiques et sociaux du dessin en y appliquant la discipline et l’obstination qui ont prévalu dans ses travaux consacrés à Natoire. Elle a d’abord étudié son œuvre graphique dans le cadre d’une thèse de doctorat nouveau régime (Charles-Joseph Natoire 1700-1777, dessinateur : étude critique et catalogue raisonné, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2002) avant de se consacrer au catalogue général et raisonné de son œuvre, fondement d’une étude et d’une compréhension de sa personnalité et de son rôle artistique. C’est donc le résultat de quinze années de recherche et de réflexion que donne à considérer cette publication fort attendue, dont la qualité exceptionnelle est indéniablement le fait de son auteur et plus ponctuellement de toute une équipe associative portée par la solidarité de la recherche, dont témoignent les plus de trois cents remerciements.
Dans sa Préface (p. 7-9), Jean Patrice Marandel, conservateur en chef chargé de l’art européen au County Museum of Art de Los Angeles – auquel on doit la redécouverte de plusieurs œuvres de l’artiste –, s’interroge sur l’ignorance coupable d’un artiste célèbre en son temps et auteur de pareilles perles de l’histoire de l’art. Sa lecture de la monographie de S. Caviglia-Brunel l’incite à penser que la fortune critique de Natoire, bien différente de celle tout en éclats de son concurrent François Boucher, a été en partie déterminée par la relation qu’il entretint avec l’Italie. Selon lui, ce n’est pas une des moindres qualités de l’ouvrage que d’explorer cette relation d’élection initiée par un premier séjour à l’Académie de France à Rome en tant que pensionnaire du roi (1723-1729), qui se signalait déjà par une participation active à la sociabilité locale, et du second séjour en tant que directeur de l’Académie de France (1751-1777), par lequel il termine à la fois sa carrière et sa vie. Après avoir été remplacé à la tête de l’Académie de France par Joseph-Marie Vien en juin 1775, Natoire se retire à Castel Gandolfo où il meurt deux ans plus tard. Cette Italie-là n’est pas le mirage érudit d’une esthétique décadente ; c’est le lieu vivant de l’une des plus remarquables carrières artistiques du XVIIIe siècle, qui confronte la création d’œuvres de premier plan au contexte complexe de la société ultramontaine, non sans aboutir quelquefois à des malentendus artistiques aussi regrettables qu’instructifs.
L’ouvrage en lui-même se compose de trois grands ensembles : une étude chronologique de la vie et de l’art du peintre fragmentée en trois grands chapitres (p. 11-167), un catalogue de l’œuvre (p. 168-524) et une série d’annexes (p. 525-583). L’introduction de l’étude (p. 11-13) fait le point sur une fortune critique paresseuse qui a fait de Natoire, dans le meilleur des cas, un « talent léger, facile et naturel » (Charles Blanc) et plus généralement un artiste mineur au talent dépourvu d’originalité, avant que lui soit consacrée une première exposition rétrospective à l’occasion du bicentenaire de sa mort en 1977. L’auteur explique le délai de près de quarante ans qui sépare celle-ci du premier catalogue raisonné de son œuvre par l’importance du corpus pressentie en 1977 (plus de deux mille œuvres mentionnées par les différentes sources) et la nécessité, conséquente et raisonnable, « d’accepter l’idée qu’un tel travail soit forcément incomplet ». Il va de soi que de nombreuses œuvres de Natoire réapparaîtront dans les années à venir ; le présent ouvrage se présente donc avec modestie comme un état de la question, même si l’on y trouve une mise au point qui fera date quant à son rôle institutionnel, sa place dans les réseaux artistiques et son influence pédagogique. Ce sont ces objectifs de documentation qui expliquent le plan chronologique de l’étude, qui « permet de se rendre compte de la façon dont les charges qu’il a revêtues ont scandé son existence, ses lieux de résidence, son œuvre aussi, car les mutations qu’on y relève sont concomitantes » (p. 12). Plus qu’un aménagement commode du propos, ce parti constitue une méthode à part entière qui permet notamment d’évacuer les problématiques archaïques de l’histoire stylistique de l’art (Rocaille, Retour à l’antique et Néoclassicisme). Formant un cadre particulièrement discriminant pour des artistes au caractère indépendant et discret, qui n’en sont pas moins d’authentiques créateurs, ces catégories éculées empêchent toute analyse subtile des relations entre la vie et les œuvres et hypothèquent le projet de « faire ressortir l’ensemble des tensions, des difficultés, des concessions, des luttes secrètes qui sont sous-jacentes à celles-ci » (p. 13).
Les années d’apprentissage, jusqu’en 1730 (p. 14-41), sont l’objet de la première partie de l’étude. Une problématique claire la gouverne : « comment Natoire met-il en place une méthode de travail originale, étroitement liée à la définition de sa poétique future, qui aura comme fondement la réflexion sur les modèles artistiques » ? Les exercices académiques ne seront pas étudiés ici comme des instantanés plus ou moins fonctionnels de l’apprentissage mais comme les authentiques sources du projet que porte en lui tout artiste dès qu’il envisage de se distinguer dans une carrière aussi aride que celle que conditionne la peinture d’histoire du XVIIIe siècle. Dans le cas présent, le recours à toutes les formes de documentation, jusqu’aux témoins complexes que constituent les œuvres elles-mêmes, est d’autant plus recommandé qu’il n’existe aucune biographie du peintre rédigée par des contemporains ; l’absence d’une « vie », rédigée ordinairement par un ressortissant du corps académique, est d’ailleurs symptomatique de la fortune critique du peintre, hélas gouvernée par les démêlés judiciaires et financiers qu’il connut à la fin de son directorat de l’Académie de France à Rome. Cet état de fait n’est pas entièrement regrettable, les nécrologies n’étant pas toujours d’une grande objectivité. L’auteur s’est donc concentré sur les sources de première main : archives communales nîmoises, minutes et correspondances institutionnelles, lettres de son ami Antoine Duchesne, archives des académies parisiennes et romaines, catalogues de vente etc.... Ce matériau permet de cerner avec clarté le contexte catholique d’une enfance marquée par la révolte des Camisards (1702-1710) et par le « dualisme confessionnel qui structure largement le champ politique et même socio-économique » (p. 16). Protégée par l’évêque Jean VIII César Rousseau de la Parisière, la famille de Natoire entretient des relations soutenues avec les Jésuites, initiant une relation durable qui marquera la carrière romaine du peintre – jusqu’au conflit majeur que marque la condamnation de la compagnie au milieu des années 1760. Artisan-sculpteur, le père du peintre, Florent Natoire, s’était établi à Nîmes après avoir appris l’architecture et la sculpture à Paris – sa mère est elle-même issue d’une famille de sculpteurs d’origine toulousaine. Les travaux de décoration que Florent réalise pour la ville l’ont, semble-t-il, distingué puisqu’il en devient consul en 1722 – signe, avec le fait que Charles-Joseph fut le seul de ses dix enfants à devenir artiste, d’une ambition qui ne se cantonnait pas à la carrière artistique. S. Caviglia-Brunel recompose ainsi le contexte de l’entrée en apprentissage à Paris (1717), qui se présente à tous égards comme le premier stade d’une ascension sociale et professionnelle inscrite dans un projet de réussite familiale largement mis en œuvre par Florent Natoire et que viendront couronner la croix et le cordon de l’ordre de Saint-Michel accordés à son fils le 27 août 1755.
C’est chez le peintre Louis Galloche (1670-1761), dont aucune monographie ne permet à ce jour de juger de l’œuvre pourtant admiré dans le second tiers du XVIIIe siècle, que Charles-Joseph entame donc un apprentissage parisien qui va le distinguer très rapidement, puisqu’il obtient l’année même de son arrivée une première médaille de Dessin à l’Académie royale de peinture et sculpture. Si l’influence académique de Galloche, tenu pour un bon pédagogue en un temps où les ateliers des artistes avaient aussi une fonction lucrative, détermina sans doute ce premier succès, il est probable que la médaille rendait aussi hommage à la première formation nîmoise de l’artiste. S. Caviglia-Brunel souligne en outre toute l’importance qu’un Galloche pouvait accorder à la discipline du dessin « dans le respect de l’Antique et de la Nature », deux attendus parfois contradictoires dont les peintres français des années 1710 ne se firent pas forcément les hérauts. Partie intégrante du corps de doctrine moyen des peintres académiciens, l’observation des grands maîtres tient aussi une place importante dans le Traité de peinture de Louis Galloche. Lu sous forme de conférences à l’Académie royale de 1750 à 1753, ce témoignage atteste une vraie motivation didactique en même temps qu’il renseigne sur l’origine de certaines habitudes professorales de Natoire. Il en va ainsi de l’excursion champêtre visant à « puiser dans la nature même les plus beaux effets que produisent les saisons différentes : c’est là que l’on peut étudier les principes de l’harmonie, en établissant pour juge infaillible le soleil, qui en est l’auteur » (Galloche, Traité de peinture, 4e partie, cit. p. 18). Pas de doute que cette conception solaire du coloris, qui déterminera l’éclaircissement de la palette ainsi qu’une quête d’objectivité naturelle et quasi flamande dans la représentation, a profondément marqué Natoire et sa génération, quelquefois incomprise sur ce principe même. Tenue pour décorative dès les années 1780, elle correspondait en fait, vers 1720, à une préoccupation empirique et naturaliste en phase parfaite avec l’évolution de la théorie contemporaine de la connaissance.
S. Caviglia-Brunel ne cache pas les zones d’ombre qui hypothèquent notre connaissance des débuts de Natoire : le passage, que l’auteur propose de situer vers 1719, de l’atelier de Galloche à celui de François Lemoyne (1688-1737), s’avère impossible à documenter. Toutefois on comprend bien qu’un jeune peintre ambitieux, peut-être conseillé par un maître qui lui voulait du bien, ait désiré la protection de l’un des professeurs adjoints à l’Académie les plus en vue et les mieux en cour, premier peintre du roi en 1736 mais crédité dès lors des suffrages de la direction des Bâtiments et des collectionneurs. Effet envisageable de cette nouvelle direction d’apprentissage : Natoire remporte le 30 août 1721 le Grand Prix de Peinture avec Le Sacrifice de Manué (cat. P. 1) composé d’hommages délicats aux manières de Galloche et Lemoyne mais aussi de Watteau, avec des clins d’œil à la tradition vénéto-parmesane (Giorgione, Corrège, Parmesan). Ces références nourrissent toutes une « diplomatique » (Christian Michel) de l’imitation des maîtres et du maître dont les enjeux artistiques sont parfaitement analysés ici, même si l’on regrette que les travaux qui ont été consacrés depuis dix ans à cette culture académique de la citation ne soient pas référencés.
Natoire s’installe dans la Ville Éternelle dans le contexte de la reprise en main de l’Académie de France à Rome par le peintre d’origine flamande Nicolas Vlegheuls et de son habile négociation, le 31 mai 1725, du bail de location du monumental Palazzo Mancini sur le Corso, immortalisé, au temps de sa splendeur académique, par une célèbre gravure de Piranèse. S. Caviglia-Brunel consacre une étude approfondie aux conditions de vie et d’étude des pensionnaires du roi à Rome à une époque où le Grand Prix n’ouvrait pas automatiquement le droit d’y séjourner – dans le cas présent, une série de copies autographes à la sanguine documentent précisément le choix des artistes de référence qui s’imposent alors à Natoire : Michel-Ange, le cavalier Bernin et Pierre de Cortone, auxquels s’ajoutent le Bolonais Annibal Carrache et ses élèves Guido Reni, Dominiquin et Lanfranco, particulièrement appréciés par les Français. Cette option pédagogique résolument moderne que choisit le directeur de l’Académie de France visait à ranimer l’intérêt des étudiants pour l’exercice de la copie et à pallier une certaine lassitude, bien renseignée par la Correspondance des directeurs, pour l’antique et, dans une certaine mesure, pour Raphaël. Les morceaux dits « d’invention » illustrent aussi le sens tout particulier que Nicolas Vleughels avait de l’émulation ; certains d’entre eux lui permettront de décorer l’étage noble du Palazzo Mancini et d’autres feront même l’objet, en dépit du règlement qui les interdisait, de commandes de grands amateurs, comme le cardinal de Polignac, pour qui Natoire exécute en 1727 le dynamique Christ chassant les marchands du temple aujourd’hui accroché dans la chapelle des fonts baptismaux de l’église Saint-Médard à Paris. On voit ici que Vleughels savait s’émanciper à l’occasion de directives d’étude parfaitement justifiées mais dont il avait compris que l’application trop stricte conduirait à faire renaître les tensions entre la direction et les pensionnaires qui, jointes à la pénurie financière, avaient failli conduire à la fermeture de l’Académie dans les années 1690-1715.
Promoteur d’un « système d’étude rigoureux et libre à la fois » (p. 27), Vleughels favorise l’étude des restes de l’antiquité dans la campagne romaine, légèrement différente de l’étude du paysage d’après nature, dans la mesure où elle mobilise l’attention des jeunes artistes sur la charge métaphorique que contient la dialectique de la ruine et de la nature. Cet atelier champêtre que reprendra à son compte Natoire lorsqu’il deviendra à son tour directeur de l’Académie de France en 1751, prend place dans un emploi du temps variant avec les saisons et les heures, l’hiver étant majoritairement consacré à la copie d’après l’antique et au dessin d’après les œuvres prêtées par le directeur et le printemps aux visites de palais et d’églises ainsi qu’à l’étude in situ de l’antique, des grands maîtres et de la campagne romaine. Ces éléments, bien exposés dans l’ouvrage classique de Jean Locquin (La peinture d’histoire en France de 1747 à 1785. Étude sur l’évolution des idées artistiques dans la seconde moitié du XVIIIe siècle), que les éditions Arthena avaient légitimement réédité en 1978, s’enrichissent ici d’informations relatives aux rencontres, découvertes et collaborations (p. 27-30) des pensionnaires durant le séjour de Natoire, plus rarement évoquées par la bibliographie : la participation de ce dernier au Concorso Clementino de l’Accademia di San Luca en 1725, où il remporte le Premier prix (voir cat. D. 67) de la première classe ex æquo avec deux artistes italiens issus de l’enseignement de Carlo Maratta (1625-1713), ou encore sa contribution, associée à celle de l’Aixois Michel-François Dandré-Bardon, à l’illustration du De Cultu sacrosancti cordis Dei ac Domini nostri Jesu Christi du père Joseph Gallifet publié à Rome, chez Jean-Marie Salvioni, en 1726 (cat. D. 71-74). Dans la lignée de la propaganda fidei, cette publication militante atteste d’ailleurs la vigueur des liens noués par le peintre avec la compagnie de Jésus dès son enfance nîmoise.
Le cas Natoire montre ainsi avec une grande précision comment le séjour des pensionnaires du roi sous Vleughels renoue finalement avec des rythmes et des relations qui avaient été ceux des séjours d’étude antérieurs à la fondation de l’Académie, lesquels faisaient la part belle à l’étude scrupuleuse des artistes italiens contemporains (p. 30-34) – Francesco Trevisani et Agostino Masucci dans le cas de Natoire, qui rend un hommage d’une délicatesse sans pareille à ce dernier avec l’Adoration des mages reproduite page 33 (cat. P. 6), hélas non localisée. À tous points de vue, le séjour en Italie rend ainsi compte de l’accomplissement d’une formation (p. 34-41), que renseigne un important addendum au séjour. Il s’agit du voyage en Italie du Nord (p. 34-37), lors duquel le peintre visite Florence et Bologne, la belle copie à la sanguine de la Madone Bargellini du musée du Louvre (cat. D. 86) attestant son intérêt pour l’art de Ludovic Carrache, a priori bien différent du sien. S. Caviglia-Brunel envisage aussi qu’il soit passé par Modène, Milan et Gênes en plus de Venise, où sa présence est attestée le 11 janvier 1729 par une lettre d’Anton-Maria Zanetti au chevalier Gabburri (p. 35) – on gage que la publication prochaine de la thèse de Valentine Toutain-Quintillier (Prix Nicole 2012), consacrée aux relations artistiques entre la Sérénissime et Paris du vivant de Rosalba Carriera, permettra d’enrichir encore le dossier riche en découvertes des détours géographiques effectués par les pensionnaires du roi au retour de Rome dans la première moitié du XVIIIe siècle. Car c’est grâce à cet effort, dont le moyen financier était généralement consenti gracieusement par la direction des Bâtiments, que les jeunes artistes purent enrichir leur culture artistique en un temps où celle-ci était devenue, via les références et citations subtiles, un ornement apprécié et même attendu de la manière des académiciens. Le délicat pastel à la manière de Rosalba Carriera reproduit page 36 introduit ainsi d’instructives réflexions sur la mémoire des arts et l’art de la mémoire (p. 37-39). Y est exposée, exemples à l’appui, l’évolution qui caractérise « la manière dont Natoire interroge ses modèles […] entre le séjour à Rome et le voyage en Italie du Nord » (p. 38), marquée par le glissement d’une concentration sur des motifs précis et aisément remployables dans des compositions autres à une concentration d’ensemble sur le style des œuvres copiées. Toujours méthodique, cette démarche qui implique que soit adopté et pratiqué le point de vue des prédécesseurs avant et afin que s’affirme une manière personnelle, fait finalement l’objet d’une synthèse intitulée « L’art de la référence : vers une poétique personnelle » (p. 39-41) qui définit le fondement paradoxal mais très fertile de la poétique que mettra en œuvre Natoire dès son retour à Paris. Celle-ci consiste en une émulation avec les grands maîtres, fondée sur une citation méthodique et savante qui n’anéantit pas la cohérence stylistique mais, bien au contraire, l’enrichit de différents degrés d’appréhension sensible et de lecture. Très différent en cela d’un Boucher, mais proche d’un Carle Vanloo et d’un Jean-Baptiste-Marie Pierre, Natoire s’affirme ainsi comme un maître de l’iconicité picturale, notion que ne reprend pas à son compte S. Caviglia-Brunel mais qui n’aurait pas nui à la facture classique de son exposé.
La deuxième partie de l’essai est consacrée aux années parisiennes dites ici « de la maturité » (p. 42-116), soit les deux décennies (1730-1751) lors desquelles Natoire s’affirme comme un talent incontournable pour la direction des Bâtiments du roi, qui requiert sa contribution sur de nombreux chantiers, et pour les collectionneurs et amateurs qu’enthousiasme sa manière patiemment mûrie à l’exemple des grands maîtres italiens. Une première section intitulée « Vers une nouvelle peinture d’histoire » (p. 43-58) s’amorce avec son agrément à l’Académie royale le 30 septembre 1730, examen de passage dont la réussite était sans surprise pour le pensionnaire modèle qu’il avait été à Rome – le Mercure de France fait l’éloge des espérances qu’il donne dès novembre 1730. Au demeurant, le « nombre et la qualité des commandes que Natoire obtient avant même d’être reçu académicien en 1734 confirmait sa position exceptionnelle parmi les peintres de la nouvelle génération. » (p. 43). Dès 1731, il reçut en effet du contrôleur général des Finances Philibert Orry, la commande d’une série de neuf peintures illustrant l’« Histoire des dieux » destinée à son château de La Chapelle-Godefroy à Saint-Aubin dans l’Aube (cat. P. 14-22 & D. 98-11). C’est l’occasion pour S. Caviglia-Brunel de définir la stratégie stylistique qu’employa le peintre pour se démarquer de remarquables concurrents comme François Boucher et Carle Vanloo après son retour d’Italie en 1735 : articulant la science allégorique et mythologique et sa connexion intime avec certaines ambiguïtés bibliques relatives au traitement charnel de la figure féminine, ces « tableaux, où le sensuel se mêle au sensible, annoncent la mise au point d’une esthétique fondée sur le plaisir immédiat des formes, qui s’inscrit dans un rapport empathique avec le spectateur » (p. 44). Ces choix stratégiques, qui présupposent une conscience claire de l’importance de la dimension amoureuse pour la psyché humaine, vont déterminer un succès artistique (p. 52-55) déjà bien affirmé lorsque le peintre est reçu à l’Académie le 31 décembre 1734, avec son tellurique Vénus qui commande à Vulcain des armes pour Énée (Montpellier, musée Fabre, P. 32-33 & D. 135-139). Ce tableau n’est pas sans rendre un hommage en forme de défi à François Boucher qui avait exécuté le thème pour François Derbais en 1732.
Que le nom de Natoire ait été avancé dès 1737 pour succéder à Vleughels à la direction de l’Académie de France (p. 52) témoigne à la fois du bon souvenir qu’il y avait laissé et des espoirs qu’il suscitait auprès de Philibert Orry, nommé en 1736 directeur général des Bâtiments du roi. Après l’achèvement de l’« Histoire des Dieux » entre 1735 et 1737, ce dernier commanda à Natoire une série sur le thème des « Quatre saisons » (P. 37-40 & D. 146-147 bis) puis le cycle historique pionnier consacré à l’« Histoire de Clovis » (P. 47-52 & D. 172-182) en pendant d’une « Histoire de Télémaque » (P. 111-117 & D. 281-289). S. Caviglia-Brunel renseigne cette première fortune de Natoire en France mais aussi à l’étranger, dans les cours allemande et suédoise, attestant ainsi un renouveau de la peinture d’histoire dès avant le rétablissement du Salon de peinture en 1737. De ce renouveau, le premier témoin est la critique d’art. L’auteur documente sa contribution didactique à la promotion de la peinture d’histoire sensuelle que propose Natoire (p. 55-58), en étudiant notamment son champ lexical organisé autour des notions d’élégance, d’agrément et de vérité. Loin de la recherche censément objective qui primera après la publication des Réflexions de La Font de Saint-Yenne en 1747, cette première critique propose une lecture empathique appuyée sur les correspondances de la peinture et de la poésie, une préoccupation chère à la génération de Natoire, dont l’incompréhension repose bien souvent sur la dénégation de cet impératif fusionnel, pourtant bien exposé dans l’Épître à mon fils d’Antoine Coypel (1708 et années suivantes pour les commentaires), référence centrale de la poétique picturale des années 1710-1730. C’est en bon connaisseur de cette didactique lyrique et critique que l’auteur propose une seconde section qui rapporte non sans audace la peinture d’histoire de Natoire à une méditation sur la grâce (p. 58-64), étude suivie d’une mise au point attendue sur le cycle de l’« Histoire de Psyché » peint pour l’hôtel de Soubise (p. 64-70, cat. P. 92-99 & D. 252-265). Ce cycle exemplaire de l’hédonisme poétique de ce « Grand Siècle » que fut aussi le XVIIIe siècle a sans doute donné des ailes à son auteur et libéré son désir obstiné de régénérer la peinture par l’exploration de nouveaux thèmes faisant jouer l’« hybridation des genres ». L’« Histoire de Don Quichotte » fait ici l’objet d’une présentation de notre point de vue inédite dans son détail (p. 71-77, cat. P. 60-74 & D. 193-224) et introduit l’une des grandes problématiques de l’art moderne et contemporain, celle des traitements « mixtes » (p. 77-78) : aux sources de L’assassinat de saint Thomas Becket de Delacroix et de bien d’autres œuvres du premier XIXe siècle, on trouve en effet des incunables signés Natoire mettant en scène l’histoire contemporaine (cas de l’Entrée solennelle de Monseigneur Nicolas-Joseph de Pâris à Orléans, p. 78-80, cat. P. 169) et bien sûr une histoire nationale remontant à l’époque des Francs (« Histoire de Clovis », p. 81-85).
Cet intérêt particulier qu’eut Natoire pour des sujets qui ne correspondaient pas exactement à l’idée académique de la peinture d’histoire, souveraine des genres pour les raisons libérales que lui conférait sa puissance métaphorique, alimentait d’évidence « l’idée du peintre parfait » (R. de Piles) que l’artiste s’efforçait de donner de lui-même. Ainsi, l’histoire nationale et contemporaine complétait efficacement les registres maîtrisés de la mythologie et la poésie bucolique de l’Antiquité (magistralement revisitée dans le Triomphe de Bacchus exécuté pour le concours de 1747, p. 86-90, cat. P. 187 & D. 415-418), non sans que soit laissé de côté le genre rare en France du grand décor illusionniste : S. Caviglia-Brunel consacre à celui, hélas disparu, de la chapelle des Enfants-Trouvés (cat. P. 191-205 & D. 422-449), une analyse exigeante qui souligne l’ambition symphonique du peintre de fusionner architecture feinte et scènes de genre (p. 90-94). Très logiquement, la troisième section consacrée aux années parisiennes de la maturité revient enfin sur la question à la fois poétique et technologique de la « fabrique de l’histoire » (p. 94-114). Loin des discours opaques et esthétisants sur la pratique du dessin, celle-ci se trouve ici restituée dans sa fonction productive : démonstration est faite, à l’appui d’œuvres qui sont autant d’étapes de la création au statut et à la coordination bien identifiés, comment la copie sert naturellement le remploi (p. 94-99) et comment les dessins d’académie (p. 99-100), souvent présentés comme de purs exercices de style, nourrissent une délicate herméneutique de la figure humaine, dont la maîtrise plastique prouve alors à chacun l’intelligence libérale du peintre. De celle-ci témoigne aussi la diversité des techniques employées (p. 100-102) et la diversité des styles (p. 102-104) qui en découle souvent, du simple fait que le style, ou plutôt la manière, pour reprendre la notion dont use le milieu du XVIIIe siècle, est alors conçue comme une complexe équation convoquant le type du sujet au même titre que la personnalité artistique, la technique choisie tout autant que la dimension et la fonction de l’œuvre finale. Jusqu’aux relations entre le dessin et la peinture (p. 104-109), la pratique de Natoire permet d’envisager sur un mode rationnel la critique génétique des œuvres peintes de l’ancienne tradition académique (p. 109-114) et d’en révéler l’un des enjeux essentiels. Ce dernier consiste en une scientificité méthodique et critique, qui, pour exiger du dessin qu’il régénère totalement une conception picturale, lui confère au final cette incroyable qualité de facture qui assure encore aujourd’hui son succès dans les salons. Parfaitement en accord avec l’idée de « progrès des arts réunis » qui structure en profondeur les Lumières pétulantes des années 1750, l’esprit artistique de Natoire, que soutient une vraie culture de lettré et de savant, avait sans doute de quoi inquiéter ses concurrents. À cet égard, sa nomination à la direction de l’Académie de France à Rome en 1751 peut être interprétée – ce dont S. Caviglia-Brunel s’abstient mais que nous prenons la liberté d’envisager – aussi bien comme un glorieux écartement que comme une récompense de son talent.
La troisième partie de cette passionnante et copieuse étude se consacre au second séjour de Natoire à Rome (1751-1777) clôturant sa carrière en même temps que sa vie (p. 115-165). Un de ses grands mérites est de permettre au lecteur de comprendre, au bénéfice d’une contextualisation précise, les variations que présente son œuvre dans le cadre du transfert du milieu parisien au milieu romain. Et, ici encore, nous sommes invités à une réflexion pointue sur les aléas et les modifications du style qu’imposent les conditions changeantes d’une carrière, et donc à une reconsidération implicite de l’habitude trop répandue d’attribuer à des contingences psychologiques et personnelles des évolutions qui sont dues avant tout au goût et aux attentes du milieu. La très belle Clorinde mourante baptisée par Tancrède reproduite page 118 (cat. P. 270), démontre à elle seule que le recours à la manière brune inspirée du caravagesque Valentin de Boulogne est largement induit par les attentes d’un engouement local. En attestent les périodiques rétrospectives que les institutions romaines consacrent à la fortune européenne de Caravage.
S. Caviglia-Brunel revient tout d’abord sur l’œuvre du directeur de l’Académie de France que fut Natoire (p. 115-120). Sans insister sur les évidentes qualités artistiques mais aussi de probité et de douceur par lesquelles l’homme avait su se faire apprécier malgré les habituelles intrigues liées à ce type de nomination, l’auteur se concentre sur les enjeux politiques et esthétiques qui étaient ceux de l’Académie dans le troisième quart du XVIIIe siècle (p. 115-120) – notamment après le directorat polémique de Jean-François de Troy, taxé d’avoir réintroduit le laisser-aller dans une institution à la fonction dès lors contestée. Et cette contestation n’était pas seulement française. En effet, la haine des Romains pour les pensionnaires (p. 119), la concurrence des autres « Nations » artistiques sur fond de guerres triangulaires entre la France, la Prusse et l’Angleterre, la difficulté qu’éprouvent les pensionnaires lorsqu’ils voyagent en Italie ainsi que la fonction diplomatique quasi officielle du Palazzo Mancini à l’égard de la papauté et son obligation de coordonner son action avec l’Ambassade de France, toutes ces contingences et bien d’autres encore compliquaient, en même temps qu’elles la reconfiguraient, la fonction directoriale de Natoire. Avec l’appui d’Abel-François Poisson de Vandières, marquis de Marigny en 1754 mais nommé dès 1751 directeur des Bâtiments, Natoire exerce durant plus de vingt ans les fonctions conjuguées de pédagogue et de diplomate (p. 121-139) en restaurant le programme de Vleughels qu’il avait bien connu en tant que pensionnaire. Par son entremise et grâce à un usage savant de la sociabilité à laquelle contribue tout ce que Rome contient de chargés d’affaires français et d’Italiens francophiles, les « permissions » de copie dans les églises et les palais sont accordées avec grâce. Le cas de la galerie du Palais Farnèse peinte sous la direction d’Annibal Carrache vers 1600 – un modèle révéré de l’art français depuis Charles Le Brun – permet de comprendre qu’en la matière, aucune autorisation ne créait de droit pérenne, le remplacement d’un interlocuteur par un autre exigeant de renégocier entièrement les conditions de l’accès.
C’est pourtant au prix de cette activité diplomatique qui dut être éprouvante que Natoire réussit à restaurer un programme ambitieux mêlant tous les attendus de la présence artistique française à Rome, en premier lieu la pratique de la copie (p. 122-124) et l’étude de la statuaire antique (p. 124-127). S’il encourage l’engouement des élèves pour les prospections archéologiques novatrices d’un Julien-David Le Roy (1724-1803), l’étude d’après modèle (p. 127-130), exercice phare des peintres briguant le statut d’académicien, fait aussi l’objet d’envois semestriels, puis annuels (1760), âprement commentés par les autorités parisiennes. Il encourage pareillement les études de fantaisie (p. 130-131), propres au délassement de la créativité, et favorise l’étude de la perspective et de l’anatomie (p. 131-132), quoique les Réglemens qui doivent être observés par les pensionnaires […] estiment alors que les recueils de modèles publiés par le Père Pozzo et le célèbre « écorché » de Houdon suffisent amplement à ces matières. Une plus grande liberté fut laissée au directeur pour l’étude du paysage (p. 132-136) et les résultats qu’il obtint ici sont bien démontrés par l’étude comparée de ses propres dessins et de ceux de certains élèves comme Fragonard ou simples pensionnés comme Hubert Robert. D’une génération à l’autre, le glissement d’une sensibilité du pittoresque narratif à la poésie tellurique de la ruine est sensible et atteste clairement la qualité du maître et directeur, qui est de conduire les pensionnaires sur le chemin de la différence. Cette question de l’exemple du maître fait d’ailleurs l’objet d’un paragraphe très neuf consacré aux copies et dessins des élèves retouchés par Natoire (p. 137-139), lequel renvoie à une section entière du catalogue. Celle-ci relève le défi d’intégrer au catalogue raisonné des œuvres autographes des productions dont le statut hybride et collectif, a priori exogène, renseigne particulièrement l’étude génétique de l’entourage de Natoire.
Mais le maître apprécié est aussi un administrateur (p. 139-142). Le directeur des Bâtiments du roi attend notamment de lui qu’il transmette aux pensionnaires la science des bonnes manières et de la tenue alors généralement attendues d’un artiste appelé à intégrer les salons à la mode. Il doit donc donner l’exemple en gouvernant la table des élèves et veiller à leur santé, aux dettes qu’ils contractent (Victor Louis en 1759), aux voyages en Italie qu’ils s’offrent sans autorisation (Lavallée-Poussin en 1764), aux chambres qu’ils revendiquent dans le palais, ainsi qu’aux obligations qui leur sont faites statutairement – ce en quoi il fut secondé par sa sœur Jeanne. Lorsqu’en 1753 le peintre architecte Charles-Louis Clérisseau refuse de faire ses Pâques, cette ingérence semble avoir été si bien pratiquée que le jeune homme préféra quitter l’Académie plutôt que de faire ses excuses au directeur (p. 141). En 1767, l’architecte Adrien Mouton fera de même avant de porter plainte, obtenant finalement du Châtelet la condamnation de Natoire avec dommages et intérêts. En appel, le procès n’eut finalement pas de suite en raison de l’exil du Parlement de Paris. Dans le contexte de la condamnation unilatérale de la Compagnie de Jésus, l’ami des Jésuites qu’était Natoire devait nécessairement pâtir d’une pareille plainte. Toutefois, la hargne de Mouton, documentée par plusieurs mémoires, associe des motivations diverses : le gallicanisme sourdement janséniste des petites élites bourgeoises, le conflit générationnel, mais aussi l’évidente jalousie d’un architecte sans grand talent pour l’aura d’un directeur qui ne devait finalement sa relation d’élection avec le milieu romain qu’à la diversité de ses compétences.
S. Caviglia-Brunel consacre justement à celle-ci une analyse approfondie et actualisée (« L’artiste dans la multiplicité de ses aspects », p. 143-162), qui revient notamment sur sa production pour les églises et les collections romaines (p. 149-158). Est ainsi rouvert le dossier polémique du plafond de l’église Saint-Louis-des-Français sur le thème de l’apothéose de saint Louis exécuté entre 1754 et 1756 (cat. P. 236-237 & D. 510-520), dont Anton Raphael Mengs a produit une critique amusante mais partiale. Se refusant à considérer les attentes esthétiques spécifiquement romaines de cette composition, dont l’auteur rappelle ici qu’elle forme un élégant hommage stylistique à La glorification de sainte Cécile peinte par Sebastiano Conca au plafond de Santa Cecilia in Trastevere (1721-1724), Mengs démontrait ainsi son mépris pour le milieu et la tradition picturale romaine, ici réactivée par l’exécution du dessin de Natoire à fresque par le peintre italien Antonio Bicchierai. Face à ce que l’on considère injustement comme un fiasco, mais qui avait l’ambition de se fondre dans un horizon artistique plutôt que de s’en distinguer avec brutalité, c’est toute l’attitude diplomatique de Natoire qui est ici replacée dans le contexte d’une relation intime avec la société locale – forme d’empathie assez rare chez un directeur de l’Académie de France dont rend compte encore son apport remarquable à la représentation de la Ville Éternelle (p. 159-162). Quant aux dernières années (p. 163-165), l’auteur ne cache pas qu’à « partir de la fin des années 1760, le peintre semble perdre une partie de ses moyens » (p. 163). Au-delà de l’âge et de la fatigue générée par plus de quarante-cinq ans de service, le remplacement de Marigny par l’abbé Terray en juillet 1773, qui s’assortit de nouvelles exigences artistiques et politiques, le confina dans un repli qu’aggravèrent sans doute son procès contre Mouton et la disparition de sa sœur Jeanne le 26 juillet 1776.
Rendre compte de la carrière d’un artiste chargé de commandes prestigieuses et de responsabilités institutionnelles stratégiques ne peut pas se faire en jouant de quelques épithètes stylistiques plus ou moins creuses. C’est la complexité de l’histoire et de l’art de l’ancienne tradition académique que réfléchit ainsi l’étude par S. Caviglia-Brunel de la trajectoire picturale de Natoire. Elle conjugue une connaissance approfondie des sources à un effort catalographique irréprochable, fondement du propos que nous venons de résumer. Précédé d’une note utile relative à son organisation (p. 171), ce catalogue est constitué d’un tronc commun chronologique associant peintures et dessins que les sources permettaient de situer dans le temps (p. 168-483) et auxquels sont associées les Copies exécutées à Rome et dans les environs (p. 468-476), les Copies exécutées à Naples (p. 476-477) et les Académies (p. 477-482). On trouve à la suite les Dessins non datés connus par la contre-épreuve (p. 482), les Œuvres non datées connues par la gravure (p. 484-486), les Œuvres non datées connues par un croquis de Gabriel de Saint-Aubin (p. 487-490) et les Œuvres non datables connues par des mentions dans les sources du XVIIIe siècle (p. 490-495). Trois dernières sections sont enfin consacrées aux Œuvres mentionnées non cataloguées (peintures et dessins perdus dont on ne connaît aucune reproduction ou croquis, p. 496), aux Dessins retouchés (section un rien expérimentale et sans prétention d’exhaustivité, p. 497-507) et aux Œuvres rejetées (p. 508-521). Ce classement, sans doute pas assez structuré par la mise en page et curieusement simplifié dans la Table des matières, est exemplaire d’un point de vue méthodologique. Non seulement il rend compte de la complexité qu’induit une perception critique de la qualité des œuvres rapportées à un artiste, mais il ajoute une exigence supplémentaire, celle de la chronologie. De fait, nombreuses sont les études d’histoire de l’art et les catalogues raisonnés qui la négligent sans façon, en choisissant de s’organiser sur un mode thématique ou iconographique, desservant ainsi largement leur objet. Ici, on voit toutes les difficultés qui ont été celles de S. Caviglia-Brunel quand elle a choisi de présenter les peintures et dessins incontestablement autographes dans un même continuum chronologique, afin de rendre évidentes les relations que l’œuvre graphique entretient avec les réalisations peintes dans la production d’un grand académicien du XVIIIe siècle. Mais plus encore : il en va aussi de la cohérence générale de l’œuvre. De ce point de vue, l’organisation du catalogue permet de saisir pour la première fois le sens et les directions prises par l’art de Natoire pendant cinquante-six ans, ainsi que l’incidence de conditions de travail et de contextes quelquefois fort différents. La composition des doubles-pages a particulièrement tenu compte de la relation que Natoire a construite entre ses peintures et ses dessins, préparatoires ou non, et démontre l’aboutissement extrême des esquisses, qui ne laissent que bien peu de choses au hasard. Au vu de son œuvre graphique, le peintre soit-disant exemplaire du « rococo » se révèle d’une rigueur implacable.
Notons enfin la richesse des annexes : celle consacrée aux portraits ou autoportraits connus du peintre (Iconographie, p. 525), une chronologie qui permet une lecture abrégée de sa carrière (p. 526-529) et un « Tableau des pensionnaires sous la direction de Natoire » (p. 530-531), en plus des traditionnelles « pièces justificatives » (Documents, p. 532-538) et de la bibliographie (p. 539-548). Celle-ci inclut les sources d’archives, manuscrites et imprimées mais exclut les catalogues d’exposition auxquels est consacrée une section propre (p. 549-554). L’effort réalisé sur l’indexation des noms de personnes et de lieux, séparés des œuvres de Charles-Joseph Natoire, se révèle particulièrement utile pour circuler dans le catalogue. Il y a donc bien peu de choses à regretter, sinon la rareté de l’iconographie de comparaison, étant donné le souci constant que l’auteur accorde à la problématique de l’imitation des grands maîtres, et sans doute aussi le fait que les légendes d’œuvres ne comportent pas de dates. Le travail de recherche n’en reste pas moins colossal et la qualité de l’édition, qui propose des reproductions au chromatisme scrupuleusement contrôlé, ne connaît que trop peu d’équivalents dans le genre. |