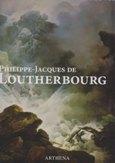|
||
|
|
||
Reviewed by Antoine Capet, Université de Rouen Number of words : 4171 words Published online 2013-11-22 Citation: Histara les comptes rendus (ISSN 2100-0700). Link: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1816
« Nul n’est prophète en son pays », dit le vieil adage auquel on pense immédiatement quand on parle de Philippe-Jacques de Loutherbourg – ou Philip James de Loutherbourg, comme on le connaît outre-Manche, notamment sur les cartels des nombreux musées – vraisemblablement plus nombreux que les musées français – qui possèdent des œuvres de sa main, ou bien encore Philipp Jacob Lautterburger, nom qui figure sur son acte de naissance (p. 16) conservé dans les archives de la ville qui s’appelait alors Straßburg. Comme l’indique excellemment l’auteur :
C’est que la plus grande partie de sa carrière, quelque quarante ans, s’est déroulée à Londres – les vingt dernières années (il mourut en 1812) dans un climat de guerre quasi permanent entre la France et la Grande-Bretagne : mieux valait donc se dire suisse, comme Olivier Lefeuvre le suggère à juste titre (p. 16). Artiste « européen » avant la lettre, donc, mais artiste qui peut-être pour cette raison « d’éclectisme » est resté difficile à cerner, ce qui peut expliquer qu’il n’ait jamais vraiment bénéficié dans la littérature scientifique, particulièrement en France, de l’attention qu’il mérite et, comme le dit le service de presse du Musée des beaux-arts de Strasbourg – qui lui a consacré une exposition du 17 novembre 2012 au 18 février 2013 (1) – qu’il soit « aujourd’hui quelque peu oublié » (2).
L’injustice est plus que rectifiée avec cette magnifique monographie qui fera date et qui restera sûrement pour de longues années l’ouvrage de référence sur Loutherbourg. Magnifique du point de vue technique : parfaite lisibilité du texte sur deux colonnes, avec commodes notes infra-paginales (sur trois colonnes) qui épargnent toute difficulté de manipulation et évitent donc toute irritation et toute tentation de paresse, dans un livre que son grand format (quarto raisin, 33 x 25) et son poids rendent inévitablement difficile à manier constamment ; abondantes illustrations, le plus souvent en quadrichromie, et fréquemment de format pleine page – voire double page ; papier glacé de fort grammage ; cahiers cousus (et non au dos massicoté noyé dans la colle) qui garantissent une ouverture aisée, notamment pour les illustrations en double page, ainsi qu’une longue durée de vie à la reliure ; on y ajoutera la présence de deux signets de couleur différente : délicate attention qu’on ne trouve que fort rarement dans les cartonnages d’éditeur.
Mais magnifique bien sûr également du point de vue scientifique, ce qui nous intéresse ici au premier chef. L’ouvrage comporte deux copieuses parties principales, avec d’abondantes et très utiles annexes. La première partie (180 pages) est consacrée à un exposé biographique (65 pages) suivi d’une analyse illustrée des œuvres (115 pages). Un catalogue raisonné de l’œuvre de Loutherbourg occupe la deuxième partie (170 pages). Viennent ensuite des annexes de nature différente. L’ouvrage est très largement issu de la thèse qu’Olivier Lefeuvre a soutenue en Sorbonne sous la direction de Barthélémy Jobert en 2008 (3), ce qui explique que les notes et l’appareil critique soient particulièrement copieux et soignés. La « Chronologie sommaire », avec ses trois pages sur trois colonnes grand format, n’est pas aussi sommaire que son intitulé pourrait le laisser croire et elle est très commode pour retrouver rapidement un événement ou une date. Les spécialistes se délecteront ensuite à la lecture du « catalogue de vente après décès », à Londres du 18 au 20 juin 1812. On peut penser que l’auteur, qui travaille actuellement chez Christie’s (4), a dû trouver un plaisir particulier à le reproduire in extenso (plus de 600 numéros, qui occupent quinze colonnes en petits caractères). Suivent des « Documents d’archives » sur sa vie privée (naissance, mariage, séparation, testament, procès) et professionnelle (lettres, notamment à Garrick, PV de la Royal Academy), puis des « Documents anciens relatifs à l’Eidophusikon ». La reproduction photographique du « Livret de l’exposition de La Grande Attaque sur Valenciennes » n’est pas facile à lire, mais elle reste parfaitement lisible et son « trombinoscope » est très précieux pour identifier les visages des protagonistes. Cinq pages de « Fortune critique » sur deux colonnes, de 1763 à 1999, confirment nos impressions préalables, à savoir que les avis sur Loutherbourg sont plus nombreux en anglais qu’en français. Comme on peut s’y attendre dans une thèse publiée, la rubrique « Sources et bibliographie » est particulièrement nourrie et parfaitement classée selon la nature des documents. Un « Index des noms de personnes et de lieux » (ces derniers en gras) est également proposé. À titre de sondage, j’y ai cherché « Rouen » – que j’ai trouvé – et « Le Havre » (dont il est fait mention p. 29-30 et qui figure dans le titre du N° 30 du catalogue : « Marine, vue du Havre depuis la mer »), qui n’est ni à H ni à L : je ne sais quelles conclusions il faut en tirer sur l’exhaustivité souhaitable de l’index. Le volume se clôt sur les classiques « Remerciements », « Crédit photographique » et « Table des matières » (bien détaillée), avec une page finale sur l’association ARTHENA, ainsi que ses objectifs et ses animateurs, qui par son mécénat a permis la publication de l’ouvrage.
Il convient maintenant de revenir sur les chapitres qui constituent la première partie. L’auteur a pris volontairement le parti de ne pas respecter la chronologie, comme il s’en explique de façon très convaincante :
Le développement s’entame malgré tout sur un substantiel chapitre (52 pages) proprement chronologique, « La vie de Philippe-Jacques de Loutherbourg » – et les choses commencent fort bien, car en regard de la première page du chapitre, nous avons un superbe autoportrait de Loutherbourg (5) en pleine page, à tel point que l’on regrette que l’éditeur ne l’ait pas retenu pour la jaquette illustrée, vraisemblablement pour des raisons « d’accroche commerciale » qui nous échappent. Les indications biographiques sont naturellement étayées par les solides sources et documents que l’auteur a rassemblés, dépouillés et exploités pour sa thèse, et l’on peut dire sans grande crainte de se tromper que son travail sur la trajectoire agitée de Loutherbourg est à ce jour sans égal : ses lieux de vie et de séjour, mais aussi ses relations tempétueuses avec sa première épouse et ses fréquents conflits avec ses contemporains qui se terminent devant la justice, ainsi que les complexités de son parcours professionnel, comme on dit de nos jours, notamment ce qu’il appelle sa « fuite » à Londres en 1771, « dont les raisons n’ont jamais été véritablement élucidées », bien que tout porte à croire qu’elles sont à rechercher dans sa vie privée (p. 32). Fait rare, il fut membre des deux académies des pays où il a longtemps vécu : la France (Académie royale de peinture et de sculpure, 1763), puis la Grande-Bretagne (Royal Academy of Arts, 1781, en même temps que Stubbs). Sachant qu’Olivier Lefeuvre a parfaitement compris qu’un Français avait bien du mal à être persona grata en Grande-Bretagne en cette période troublée (Français et Britanniques s’opposaient par Amérique interposée de 1776 à 1783), on ne voit pas pourquoi il s’étonne que la Royal Academy ne l’ait pas immédiatement coopté :
Il avait beau essayer de se faire passer pour Suisse : nul doute que les choses auraient été plus faciles s’il avait été Britannique… Les analyses puisées aux meilleures sources – souvent d’ailleurs sous la forme d’interrogations parfaitement fondées plus que de certitudes impossibles à rassembler – viennent fort opportunément éclairer les aspects les plus ténébreux des activités de Loutherbourg : ses relations avec Cagliostro, sa passion pour l’occultisme, le magnétisme et la Cabale, « sa quête de la pierre philosophale » (p. 51) et surtout ses pouvoirs supposés de guérisseur. « Pour les années 1787-1789 en tout cas, lit-on en conclusion de ce développement, il n’est pas évident que la peinture ait compté à ses yeux autant que l’alchimie » (p. 55).
Le sous-chapitre suivant, intitulé « Loutherbourg et la nation anglaise », fait bien sûr mention des circonstances de la création et de la réception des grands tableaux pour lesquels ils est resté connu même au temps de son long purgatoire, au premier chef les monumentaux The Grand Attack on Valenciennes by the Combined Armies under the Command of his Royal Highness, the Duke of York on the twenty-fifth of July 1793 (La grande attaque sur Valenciennes [1794]) et Lord Howe’s Action, or the Glorious First of June (La victoire de lord Howe, le 1er juin 1794 [1795]) (7), auxquels on peut ajouter The Defeat of the Spanish Armada, 8 August 1588 (La défaite de l’Invincible Armada [1796]) (8). Mais son grand intérêt réside dans la discussion des sentiments ambigus de Loutherbourg vis-à-vis du pays hôte, qui les lui rend bien, et l’expression anglaise damning with faint praise (9) vient immédiatement à l’esprit quand on lit les propos nécrologiques du Sun du 13 mars 1812 : « he might almost be considered as a native » (10) (p. 58-59).
Nous passons ensuite à un examen des raisons qui ont pu le pousser à s’éloigner (dans les années 1790-1800) puis à se rapprocher (les dernières années de sa vie) de la Royal Academy, avec un paragraphe qui replace excellemment Loutherbourg dans le contexte de la vie artistique londonienne des deux décennies qui entourent 1800 :
Le chapitre biographique s’achève sur « La vie paisible à Hammersmith » et enfin « La maladie et la mort », où l’on peut mesurer son évolution, aboutissant à une transformation radicale de sa personnalité :
Toute la complexité du personnage est rappelée dans les derniers paragraphes du chapitre, et ceux qui suivent en prolongent l’exploration avec bonheur.
Si l’on suit la chronologie de sa période anglaise, il convient de commencer par « Loutherbourg et les arts du théâtre », comme le fait l’auteur dans ce qu’il appelle « une longue parenthèse », qui va de 1772 à 1785. Ce sont bien sûr ses activités de décorateur de théâtre à Drury Lane et ses rapports avec le grand Garrick qui constituent l’essentiel de ces développements, avec un rappel de la marque qu’il a durablement imprimée dans sa ville d’adoption : « En moins d’une décennie, il réussit à marquer de son empreinte le monde du théâtre londonien, provoquant, comme l’écrit Pierre Franz, ‘une véritable révolution de l’image scénique’ » (p. 70). En effet, Loutherbourg ne fournit pas seulement les maquettes pour les toiles de fond : il prend également en charge les éclairages et les costumes, et demande un droit de regard sur les ballets et la musique d’accompagnement. Il impose aussi ses exigences « d’exactitude historique, topographique et ethnologique », « en opposition avec l’anachronisme jusque-là omniprésent au théâtre » (p. 74).
Un copieux sous-chapitre nous initie aux principes de fonctionnement de son invention, l’Eidophusikon « (littéralement Image de la nature) » (p. 76) – mais surtout il nous en explique le succès auprès de la haute société au cours des trois saisons (1781, 1782 puis 1786) durant lesquelles fut donné ce spectacle inédit de tableaux animés et mis en musique – par exemple un orage sur la mer suivi d’un naufrage.
Le programme du chapitre suivant, « Loutherbourg et la peinture de paysage », est parfaitement résumé par son premier paragraphe, où l’on a en regard un détail en pleine page de l’un de ses plus célèbres paysages, Coalbrookdale by Night (Vue de Coalbrookdale, de nuit [1801]) (11) :
De très heureux développements viennent nous éclairer sur le rapport de Loutherbourg avec la nature, le poids de sa formation initiale (avant, donc, les grands paysages peints en Grande-Bretagne), ses procédés de composition, le rôle du dessin et de la mémoire chez lui (en France, puis outre-Manche), le réemploi répétitif qui lui autorise une vitesse d’exécution remarquée par Diderot, qui par ailleurs dénonce la tendance au pastiche. On s’attardera tout particulièrement sur le très solide examen des deux accusations fondamentales formulées à l’encontre de Loutherbourg par ses contemporains britanniques : ses excès et sa vulgarité. Le remarquable sous-chapitre qui traite de ses excès supposés constitue à lui seul un résumé du fossé culturel que constitue la Manche, avec l’appel shakespearien à ne pas « outrepasser la modestie de la nature » (12) (p. 96) que lui lancent certains critiques. L’un des principaux reproches qu’on lui adresse porte sur « le caractère outrancier de ses couleurs » (p. 98), et le tout culmine dans la pire accusation qu’on puisse formuler à l’encontre d’un artiste : celle d’oublier les canons de l’esthétique classique pour sombrer dans la séduction facile. « La vulgarité des toiles de Loutherbourg, c’est celle du clinquant, du brillant, de l’effet pictural destiné à éblouir le public populaire » : tel est l’acte d’accusation résumé par la formule latine ad captandum vulgi parue dans un article de 1797 (p. 108-109).
Quelques pages plus loin, les sous-chapitres sur « Loutherbourg et Turner » et sur « Le paysage entre Pittoresque et Sublime » (13) permettent à l’auteur de montrer toute son érudition sur l’histoire de l’art ainsi que sur l’évolution du goût et de ce que l’on appellerait aujourd’hui les pratiques culturelles des élites britanniques, notamment leur appétence nouvelle pour le « tourisme » et les récits de voyage illustrés. On notera la belle citation de C. Offreys (1804), qui compare la peinture de paysage de Loutherbourg à celle de Turner : « plus proche de la nature que celle de Turner, qui paraît s’efforcer de faire quelque chose au-delà de la nature » (p. 115). Rendant à César ce qui appartient à César, Olivier Lefeuvre relativise cependant cette idée d’un Turner doué d’une forme supérieure d’inspiration :
Dans le développement sur « Le Sublime ou l’iconographie du paroxysme », on apprend que Loutherbourg faisait comme M. Jourdain du « sublime » sans le savoir : en effet, sa riche bibliothèque ne comprenait pas le célèbre traité de Burke paru pourtant en 1757 (14). On y trouve des remarques fort bien vues : « Chez Loutherbourg, le paysage sublime apparaît dans un premier temps comme une formule parmi d’autres, au même titre que le paysage pittoresque ou que le paysage pastoral » – ou bien encore : « Adepte de la surenchère, Loutherbourg affecte un goût pour les scènes paroxystiques qui dépasse celui de Vernet » (p. 127).
On passe ensuite à un élément encore trop souvent traité à la va-vite, quand il n’est pas totalement escamoté, dans les monographies d’artistes : « Loutherbourg et le marché de l’art de son temps ». Olivier Lefeuvre n’hésite pas à parler de son « mode de production » et de sa « cote » (nettement plus élevée de son vivant qu’ensuite – et donc le contraire de ce qui se passe le plus souvent) (p. 133). Il replace Loutherbourg dans le contexte des différentes contraintes qu’il a pu rencontrer tant en France qu’en Grande-Bretagne et discute de la façon dont il s’y soumettait avec plus ou moins de souplesse : commandes, salons, intermédiaires (marchands, courtiers et amis), et conclut de son examen des faits que l’ensemble du système le poussait vers une production pléthorique et standardisée. Olivier Lefeuvre introduit de surcroît le lecteur qui serait peu au fait des critères qui déterminent la « cote » d’un artiste dans les arcanes du marché de l’art, qui commence par la vente par l’artiste en personne à un particulier ou à un commanditaire commercial, qui peut être un éditeur ou un graveur et non un « marchand d’art » au sens strict – c’est le marché « primaire ». L’œuvre a ensuite une deuxième vie, quand elle passe de main en main au gré des reventes – c’est le marché « secondaire ». Il nous donne un exemple saisissant de la « décote » de Loutherbourg sur les deux marchés avec celui de La défaite de l’Invincible Armada, payée 500 livres à l’auteur en 1797, revendue aux enchères en 1804 pour 204 livres, puis 54 livres en 1824. Il n’explique malheureusement pas pourquoi sa cote avait plus que doublé l’année suivante, en 1825, lorsqu’elle fut rachetée par son acquéreur définitif, l’ancêtre du National Maritime Museum de Greenwich, pour 127 livres. On apprend aussi que ses toiles continuent de subir aujourd’hui « une évidente décote » (p. 146). Les fluctuations du marché de l’art du vivant de Loutherbourg et dans les décennies qui ont suivi sa mort sont très savamment replacées dans le contexte européen agité de la période révolutionnaire et des guerres napoléoniennes, de l’émergence de la bourgeoisie et de l’évolution du goût pour les différentes « écoles », qui bénéficia initialement à Loutherbourg mais conduisit ensuite au désintérêt pour ses œuvres dans la tradition hollandaise. Les deux grandes commandes de séries qui ont largement contribué à la notoriété de Loutherbourg comme peintre d’histoire sont naturellement présentes dans la discussion : les images pour la Bible du propriétaire de galerie et éditeur Macklin, quinze tableaux et cent-vingt vignettes produits entre 1789 et 1800, et la réédition de l’entreprise, cette fois pour Bowyer, vraisemblablement à partir de 1793, avec les illustrations pour la History of England de Hume, ouvrage au succès jamais démenti depuis sa parution en 1754. Parmi les œuvres liées à cette commande figure un autre tableau aux coloris « excessifs », The Great Fire of London (Le grand incendie de Londres [ ?1797]) (15).
La discussion de l’entreprise de Bowyer conduit tout naturellement Olivier Lefeuvre à la resituer dans le mouvement naissant de « l’exposition patriotique », importé semble-t-il des États-Unis, et dans un développement fort bien documenté sur « L’implication de Loutherbourg dans la peinture des victoires nationales », il montre très bien comment cet « étranger » en est venu à être embauché pour décrire des scènes de victoire britannique sur la France tout en préservant très largement sa liberté artistique – beau tour de force. Aux scènes de défaite française déjà mentionnées, on ajoutera dans ce cadre The Battle of the Nile (La bataille d’Aboukir [1800]) (16). Ce chapitre se termine sur une note négative, Olivier Lefeuvre reprenant pour l’approuver une critique de l’époque, estimant qu’elle « révèle ce qui nuira profondément à la postérité de l’artiste : sa peinture plaît au premier coup d’œil, mais, par son manque de profondeur, peine parfois à satisfaire dans la durée » (p. 176).
Le court chapitre de « Conclusion » ne cherche pas, contrairement à la loi du genre qui règne dans les ouvrages de cette nature, à réhabiliter Loutherbourg. Il s’interroge sur « la désaffection qui perdure encore aujourd’hui » à son encontre et l’auteur reprend avec la plus grande honnêteté tous les éléments qui peuvent l’expliquer et qui tiennent aux défauts de Loutherbourg eux-mêmes plus qu’à une incompréhension de la part du public. Cette désaffection serait au fond méritée. Des reproches fort sévères comme « manque de véritable profondeur de son art », « trop grande dispersion », « absence de véritable ambition artistique », « facilité », « souci de réussite commerciale », « ambition sociale », « sa pratique de la peinture reste avant tout alimentaire » ou bien « il prend rarement, semble-t-il, son art au sérieux » (p. 179-181, passim) marquent la distance que prend l’auteur vis-à-vis de son sujet, et ils culminent dans un paragraphe qui formule l’acte d’accusation principal :
Il est hors de question ici d’examiner dans le détail les 170 pages du « Catalogue raisonné » : 315 numéros (plus un addendum) d’« Œuvres autographes » qui bénéficient d’une ou plusieurs illustrations, classées chronologiquement ; 278 « Œuvres mentionnées » non illustrées, classées par genre ; 23 « Œuvres rejetées », le plus souvent illustrées en petit format. On se contentera de dire qu’on y retrouve la même érudition que dans les chapitres qui le précèdent, avec de savants développements illustrés d’un intérêt tout particulier pour « Les deux grandes batailles » (Valenciennes et lord Howe, p. 287-292) et les tableaux de « The History of England de David Hume » (p. 293-297).
Le soin apporté à la relecture est absolument remarquable, eu égard à la difficulté de ne laisser passer aucune faute dans deux langues : la seule petite « bavure » que nous ayons décelée étant une erreur sur le genre du mot « épître » (fig. 83, p. 158). Ce sans-faute ou presque est trop rare aujourd’hui pour que nous ne lui accordions pas les félicitations qu’il mérite. Certains lecteurs pourront regretter que de nombreux passage en anglais ne soient pas traduits – mais ceux qui le sont le sont impeccablement, ce qui là aussi est fort rare.
En vérité, tout est de belle facture dans cet ouvrage qui a reçu le prix Marianne Roland Michel en 2011 et il fait honneur aussi bien au monde universitaire qu’à celui du mécénat, de l’édition et de l’imprimerie de notre pays. On lui souhaite de trouver au plus vite un éditeur britannique, car après tout Loutherbourg était « presque un enfant du pays » et c’est en Grande-Bretagne que sont actuellement la plupart de ses œuvres majeures. En attendant, il va de soi que toutes les bibliothèques d’écoles des beaux-arts, des départements d’études anglophones et des instituts d’histoire – histoire de l’art et histoire tout court – se doivent de l’acquérir.
(1) Voir bref compte rendu dans La Tribune de l’art : http://www.latribunedelart.com/plus-que-quelques-jours-pour-visiter-l-exposition-loutherbourg-a-strasbourg On notera qu’Olivier Lefeuvre en était l’un des deux co-commissaires. (2) Voir le communiqué de presse sur le site du musée : http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3683&cntnt01returnid=62
(3) Lefeuvre, Olivier. « Philippe-Jacques de Loutherbourg : vie et œuvre ». Thèse de doctorat (Histoire de l’art) sous la direction de Barthélémy Jobert. Université Paris 4-Sorbonne, UFR art et archéologie, 2008. 4 vol. (1396 p., pl.) (4) Voir http://www.christies.com/features/specialist-profile-olivier-lefeuvre-2755-1.aspx (5) Visible sur le site de la National Portrait Gallery de Londres, qui l’a acquis en 1931 : http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw01790/Philippe-Jacques-de-Loutherbourg (6) Elle fut fondée en 1768. (7) Visible sur le site du National Maritime Museum de Greenwich, qui possède actuellement le tableau : http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11962.html (8) Visible sur le site du National Maritime Museum de Greenwich, qui possède actuellement le tableau : http://collections.rmg.co.uk/collections/objects/11756.html (9) Faire un éloge du bout des lèvres qui revient en réalité à une condamnation. (10) On pourrait presque le considérer comme un enfant du pays. C’est ce presque qui démolit tout… (11) Visible sur le site du Science Museum de Londres, qui possède actuellement le tableau : http://sciencemuseumdiscovery.com/blogs/collections/tag/numsciencemuseum1987-510/ (12) Hamlet, III, 2. (13) Le « sublime » a fait en 2010 l’objet d’une exposition à la Tate. Voir compte rendu dans La Tribune de l’art : http://www.latribunedelart.com/art-and-the-sublime (14) A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Traduction française. Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, par Edmund Burke. Traduit de l’anglois sur la septième édition, avec un Précis de la vie de l’auteur, par E. Lagentie de Lavaïsse. Paris : Pichon, An XI (= 1803). (15) Visible sur le site du Yale Center for British Art, qui possède actuellement la « petite version » du tableau : http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1667690 (16) Visible (mauvaise reproduction, cependant) sur le site de la Tate, qui possède actuellement le tableau : http://www.tate.org.uk/art/artworks/de-loutherbourg-the-battle-of-the-nile-t01452
|
||
|
Editors: Lorenz E. Baumer, Université de Genève ; Jan Blanc, Université de Genève ; Christian Heck, Université Lille III ; François Queyrel, École pratique des Hautes Études, Paris |
||