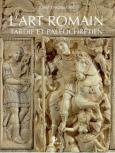|
||
|
|
||
Compte rendu par Anne Michel, Université Bordeaux Montaigne Nombre de mots : 3012 mots Publié en ligne le 2015-08-25 Citation: Histara les comptes rendus (ISSN 2100-0700). Lien: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2458 Lien pour commander ce livre
Ce livre de 269 pages, dont 256 de texte illustré de somptueuses photographies en couleurs, est le cinquième et dernier volume de la série dédiée à l’histoire de l’art romain publiée aux éditions Picard. S’attachant à la période, longtemps déconsidérée, qui va du règne des tétrarques à celui de Justinien, l’ouvrage couvre un champ chronologique plus large que celui généralement envisagé dans les livres dédiés à cette époque, puisque, sans se limiter aux régions occidentales du monde romain impérial, il inclut non seulement les premières manifestations d’un art chrétien, mais aussi les premiers siècles du monde byzantin.
D’emblée, l’auteur expose l’angle sous lequel il a choisi de considérer la production artistique, prenant l’œuvre comme le point de départ d’un commentaire qui vise à la resituer dans le contexte social de son temps plutôt que comme l’illustration d’un texte de synthèse. Pour ce faire, il adopte pour l’ouvrage un plan thématique qui se justifie par le caractère foisonnant et divers de la production artistique de la période et l’absence d’évolution formelle linéaire. Ainsi, après un premier chapitre historique destiné à ancrer les œuvres dans leur contexte, l’auteur étudie successivement, en sept chapitres d’inégale longueur, les édifices, statues et monuments impériaux dans l’espace public (chap. 2), les œuvres d’art commandées par des empereurs et consuls (chap. 3), l’interdit biblique des images et les débuts de l’art juif et chrétien (chap. 4), l’art funéraire chrétien (chap. 5), les sanctuaires chrétiens et leur décor (chap. 6), les édifices profanes et leur décor (chap. 7) et les arts artisanaux et arts précieux (chap. 8). Une part assez large est faite aux productions chrétiennes, dont le fort impact sur l’art médiéval occidental et byzantin est aujourd’hui bien connu ; l’auteur souhaite en revanche insister sur ce qu’elles doivent aux productions antérieures païennes ou profanes, qui sont moins souvent prises en compte.
Le premier chapitre (p. 9-19) pose le cadre historique, essentiellement du point de vue politique. Il s’ouvre sur une évocation de la mise en place du système tétrarchique et la prise progressive du pouvoir par Constantin et ses fils. Le discours prend appui sur des monnaies et médailles qui illustrent la permanence de l’idéologie du pouvoir impérial et le glissement progressif vers le christianisme. L’auteur rappelle les changements marquants intervenus sous le règne de Constantin avant de brosser à grands traits les principaux événements politiques de la période, de la succession de Constantin au règne de Justinien.
Les deux chapitres suivants s’attachent à la production artistique liée à l’aristocratie et aux empereurs, soulignant l’importance des liens qui unissent l’art à la politique. L’auteur y adopte la démarche à laquelle il reste fidèle tout au long de l’ouvrage avec plus ou moins de bonheur, à savoir une présentation descriptive des œuvres par ordre chronologique, accompagnée d’un commentaire en lien avec les événements historiques. Après la mention des résidences impériales des tétrarques, la première partie du chapitre s’attache à l’iconographie à l’époque tétrarchique, qui est étudiée à partir des grands monuments officiels de la période. L’auteur y souligne l’existence d’une iconographie du pouvoir fondée sur le rattachement aux divinités romaines traditionnelles, notamment Jupiter et Hercule. La seconde partie du chapitre est dédiée à l’activité édilitaire de Constantin en Occident, à laquelle succède un développement sur les œuvres liées à son règne à Constantinople et en Orient. On notera l’importance accordée à la statuaire monumentale. Qu’il s’agisse des reliefs de l’arc de Constantin ou des portraits colossaux de l’empereur à Rome, de sa statue en Apollon-Soleil radié sur son forum à Constantinople, des reliefs de la base de l’obélisque de Théodose ou des reliefs de la colonne d’Arcadius, on assiste aux derniers prolongements de la tradition gréco-romaine qui accorde une place majeure aux statues dans l’espace public : en effet, – même en tenant compte des œuvres qui ne nous seraient pas parvenues – leur nombre est divisé par cinq entre le milieu IVe et le milieu Ve siècle. Certaines de ces statues sont en fait des « reconversions » de portraits antérieurs qui interrogent sur la place et la signification des nombreux remplois.
Le chapitre 3, « Œuvres d’art commandées par empereurs et consuls », présente la production des arts précieux liée aux élites (p. 49-65). Il s’agit essentiellement d’objets portant des inscriptions votives aux empereurs, offerts à titre de cadeaux impériaux aux fonctionnaires et militaires lors de fêtes très codifiées, qui ont aussi valeur de rémunération (« largesse impériale »). La valeur du cadeau dépend de la position dans la hiérarchie sociale de celui à qui il est offert. Il s’agit le plus souvent de missoria, tels ceux de Valentinien et de Théodose, mais aussi de plats, coupes, fibules et camées. L’étude des diptyques consulaires d’ivoire offerts par les consuls lors de leur prise de fonction à l’occasion des jeux permet à l’auteur de rappeler l’évolution de la charge consulaire dans l’Antiquité tardive vers une fonction essentiellement honorifique, qui permet de faire supporter aux familles sénatoriales le coût engendré par les jeux. Ces diptyques informent simultanément sur les cadeaux offerts par les consuls et sur les spectacles en vogue à la fin de l’Antiquité, nombre d’entre eux illustrant les venationes de l’amphithéâtre.
Dans un bref chapitre 4 (p. 67-71) l’auteur s’interroge sur l’absence d’images liées au judaïsme et au christianisme durant les deux premiers siècles de l’Empire et sur le rôle qu’a joué de ce point de vue l’interdit biblique des images. Il rappelle, en s’appuyant sur des passages tirés du texte biblique et des auteurs de l’Antiquité tardive, que ce n’est pas la figuration en elle-même qui est interdite, mais celle qui est donnée comme réelle et à ce titre susceptible de faire l’objet d’idolâtrie. Il montre que s’élaborent progressivement des décors figurés dans les édifices de culte en milieu juif, d’abord avec la représentation des objets liturgiques, puis des scènes bibliques. Curieusement, les représentations du zodiaque y connaissent une fortune toute particulière ; J. Engemann s’interroge également sur le sens de la reprise de certains éléments issus du répertoire de l’iconographie impériale, notamment les victoires.
Une iconographie se développe aussi parallèlement en milieu chrétien. L’auteur rappelle le caractère douteux de l’hypothèse selon laquelle l’art chrétien serait né dans un contexte privé en cherchant à contourner les interdits des théologiens. Cependant, s’il signale que ces représentations furent très rapidement acceptées par le clergé, il n’apporte pas réellement d’éléments permettant de comprendre la rareté des images liées au judaïsme et au christianisme durant les deux premiers siècles de l’Empire, alors même que les représentations figurées étaient extrêmement répandues dans les milieux païens et profanes.
Suit, dans le chapitre 5, un long développement sur l’art funéraire chrétien (p. 73-99), qui s’attache d’abord à son apparition dans les catacombes romaines au IIIe siècle, puis à son devenir du IVe au VIe siècle. L’auteur évoque brièvement la chronologie du développement des catacombes et la typologie des sépultures, puis l’organisation des décors peints, s’attardant davantage sur l’iconographie qui s’élabore aux parois des sarcophages. Il souligne le succès particulier des représentations d’orantes, de philosophes, de pêcheurs, de bergers criophores, mais surtout des images liées à l’histoire de Jonas au IIIe siècle, ainsi que les figurations de banquets.
Après la victoire de Constantin sur Maxence en 312, les conversions se font plus nombreuses. Le développement de loculi et d’inhumations ad sanctos, privilège des élites, s’accentue. L’auteur insiste surtout, dans cette seconde partie dédiée aux IVe-VIe siècles, sur le développement d’une production de sarcophages historiés chrétiens, d’abord à frise continue, puis à double registre. On y assiste à la disparition progressive des motifs issus de l’art païen, au profit des représentations des miracles du Christ et de quelques épisodes de l’Ancien Testament. On note, dans la production romaine, l’insistance sur la personne de Pierre, beaucoup moins présent aux parois des sarcophages arlésiens et du Sud-Ouest de la Gaule. Interrompue à Rome dès la fin du IVe siècle, la production continue à Constantinople et à Ravenne jusqu’au VIe siècle, avec des scènes toujours plus synthétiques. Une évocation de la production particulière de mosaïques funéraires sur caissons spécifique aux provinces d’Afrique clôt le chapitre.
Un long développement subdivisé en trois parties est dédié aux édifices de culte chrétiens (chap. 6, p. 101-179). La première partie (p. 101-115) s’attache à l’étude des grandes fondations constantiniennes et à l’élaboration progressive d’une formule architecturale pour les lieux de culte. Si le choix de la grande halle basilicale héritée des basiliques civiles romaines s’impose, comme par exemple à Saint-Jean-du-Latran, l’auteur montre la diversité des formules architecturales adoptées : ainsi les constructions circiformes du suburbium romain, souvent associées à des mausolées sur plan circulaire prisés par la famille impériale, mais aussi les basiliques à transept comme Saint-Pierre. Il s’interroge, pour ce dernier édifice, sur l’hypothétique décor de traditio legis de l’abside.
Les édifices religieux constantiniens de Constantinople ont aujourd’hui disparu, mais sont en partie connus grâce au témoignage d’Eusèbe de Césarée. Les constructions religieuses de cette époque en Orient présentent la même diversité qu’en Occident. Plusieurs d’entre elles adoptent des plans centrés, telle l’église d’Antioche, qui a pu servir de modèle pour Saints-Serge-et-Bacchus de Constantinople ou Saint-Vital de Ravenne. Cependant, ces provinces se distinguent par la construction de grands complexes de pèlerinage autour des lieux liés à la vie du Christ. L’évocation de ces derniers permet à l’auteur de rappeler ceux qui se développent, aussi bien en Orient (Sergiopolis, Abu Mina, Thessalonique), qu’en Afrique (Tébessa), ou en Italie (Rome, Nola), comme autant de souvenirs sacrés. Cette croyance en l’action miraculeuse du Christ et des saints se développe ainsi en contradiction avec les intentions premières du christianisme, fondées sur l’adoration du Père en esprit. L’espoir des guérisons miraculeuses qui motive les pèlerins s’exprime dans l’abondance production des ampoules de Terre Sainte et de Saint-Ménas auxquelles elles ont servi de modèle au Ve siècle. On peut se demander s’il s’agit d’une croyance en la magie héritée du paganisme ou d’une composante de la religion chrétienne comme semblent l’indiquer les textes d’Augustin et d’Ambroise de Milan.
Dans la seconde partie du chapitre (p. 119-154) sont présentés les édifices religieux chrétiens des provinces occidentales postérieurs au règne de Constantin. L’auteur adopte un plan chronologique, détaillant dans un premier temps le complexe théodorien d’Aquilée. Il s’attarde ensuite sur les édifices romains des Ve et VIe siècle et leur décor, montrant la polysémie des images absidales de l’Antiquité tardive et le rôle des conciles dans la définition de certaines d’entre elles (la Vierge à l’enfant apparaît après que le concile d’Éphèse lui a attribué en 431 le statut de Theotokos). Après l’évocation des églises milanaises et napolitaines, J. Engemann consacre un bref passage au baptistère d’Albenga et à son décor unique de triple chrisme. Une rapide mention des basiliques à double abside d’Afrique du Nord et des baptistères à cuve mosaïquée précède le long développement consacré aux édifices ravennates. L’auteur montre combien le choix des décors est lié au contexte politique et religieux. Ainsi, le décor de Saint-Jean-l’Evangéliste représentant le naufrage et le sauvetage de Galla Placidia au-dessus de l’arc triomphal, que l’on peut restituer par les descriptions littéraires, avait pour but de légitimer la fondatrice de l’édifice. De même, le décor des édifices érigés au VIe siècle après le règne de Théodoric sur commande épiscopale vise à faire disparaître le souvenir de l’époque arienne, par exemple par la suppression des processions de Saint-Apollinaire-le-Neuf ou les anges portant le trisaghion, réaffirmation du concept trinitaire, à Saint-Apollinaire-in-Classe.
Après une brève mention du mobilier liturgique ravennate (ambon et « cathèdre ») et du décor de la basilique euphrasienne de Poreč, l’auteur se penche dans la dernière partie du chapitre sur des édifices constantinopolitains et des provinces orientales. Peu de vestiges subsistent des premiers en dehors de Sainte-Sophie, refaite à deux reprises au Ve et au VIe siècle après la construction de la megalè ekklèsia sous Constance en 360. D’une manière générale, l’auteur est beaucoup plus rapide sur ces édifices orientaux. Passant brièvement sur la rotonde de Galère à Thessalonique, convertie sous Théodose en église dédiée à saint Georges, il s’attarde davantage sur la mosaïque de pavement de Saint-Démétrios de Nikopolis qui représente l’image d’une terre plane entourée d’océan, semblable à celle qui se dégage des écrits de Cosmas Indikopleustès. Sont ensuite rapidement mentionnées les mosaïques absidales de l’église Panagia Angeloktistos à Kiti (Chypre) et du monastère Sainte-Catherine du Sinaï. L’évocation du monastère de Saint-Ménas en Egypte est suivie d’un développement sur les eulogies vouées à ce saint et sur celles liées au sanctuaire de Serge à Resafa. Quelques lignes sont dédiées aux œuvres liées au stylitisme et à l’iconographie relative à ces saints. L’auteur signale sans s’attarder les mosaïques spectaculaires révélées seulement depuis les années 1980-1990 dans la région de Madaba, en Jordanie.
Le chapitre 7, beaucoup plus bref, (p. 181-193) est dédié aux édifices profanes et à leur décor. Outre une évocation du portrait dit d’Eutrope, remarquable du fait que ce type de portraits tend à disparaître de l’espace public, l’auteur s’attache aux décors peints des habitats (plafond de Trèves), en opus sectile (Rome et Ostie) et de mosaïque. Passant rapidement sur le célèbre ensemble de Piazza Armerina, l’auteur souligne l’ambiguïté de l’iconographie du pavement de Hinton Saint Mary, qui associe iconographie païenne (Bellérophon et la chimère, chiens poursuivant des cerfs, les quatre vents) et chrétienne (personnage en buste derrière la tête duquel apparaît un chrisme).
Le dernier chapitre, consacré à l’artisanat et aux arts précieux (p. 195-254), envisage successivement les enluminures, la production d’orfèvrerie sacrée, les objets en métal d’usage privé, les ivoires, la glyptique, la verrerie, les céramiques, les icônes et les textiles.
Dans l’Antiquité tardive le codex a déjà remplacé le volumen qui devient, lorsqu’il est représenté, symbole d’érudition classique. J. Engemann recense les différents manuscrits connus, souvent des copies d’époque moderne d’exemplaires remontant au IXe siècle, qui illustrent aussi bien les textes de Virgile, des documents administratifs (calendrier de 354, Notitia Dignitatum) que le texte biblique. L’auteur procède ensuite à la description soignée des principales pièces d’orfèvrerie sacrée de la période, puis des objets de métal issus des trésors d’argenterie privés, sur lesquels les décors géométriques figurés païens restent largement majoritaires. Il évoque également l’abondante production de fibules wisigothiques cloisonnées des IVe-Ve siècles, les bijoux constantinopolitains à iconographie chrétienne, ainsi que les amulettes à dimension prophylactique, très diffusées. L’énumération des principaux diptyques d’ivoire privés et chrétiens précède ensuite l’étude des intailles et camées. Suit la présentation de la production de verres gravés des ateliers rhénans, celle des nombreux verres à fond doré remployés dans les catacombes romaines et de la production de verres diatrètes recueillis en milieu funéraire qui connaît un apogée au IVe siècle. Concernant la céramique, les décors moulés sur les lampes africaines illustrant les jeux du cirque et païens sont remplacés, à partir du Ve siècle, par des thèmes bibliques, puis par des croix et christogrammes à partir du siècle suivant. Le chapitre se termine par l’allusion rapide au développement des icônes et aux textiles, dont les principaux exemplaires proviennent des nécropoles coptes.
L’ouvrage, dédié à une période qui voit s’effacer progressivement les « normes » de l’hellénisme et se développer un nouvel art chrétien, occupera indéniablement une place dans la production scientifique. En effet, les synthèses grand public dédiées aux œuvres produites durant cette période qui voit se mettre en place progressivement les grands équilibres qui seront ceux de la Méditerranée médiévale sont généralement éclatées dans des livres distincts traitant de l’art romain, médiéval, ou byzantin. On ne peut donc que saluer le choix éditorial qui, regroupant les aspects païens et chrétiens encore dissociés dans les volumes de la collection Univers des formes publiée aux éditions Gallimard dans les années 1960[1], situe de ce point de vue l’ouvrage dans la lignée du petit livre de H.-I. Marrou sur l’Antiquité tardive publié en 1977[2].
Réaffirmée dans la courte postface qui tient lieu de conclusion à l’ouvrage, le choix fait par l’auteur de ne pas rédiger un texte de synthèse illustré d’images qui comporterait selon lui beaucoup trop de réflexions théoriques, mais de partir des œuvres pour les resituer dans leur contexte social est également bienvenu. L’enjeu était de taille et la synthèse difficile ; le plan adopté est judicieux et cohérent pour présenter une période aussi riche que complexe. La prise en compte d’œuvres peu connues ou récemment étudiées telles que les eulogies, les éléments liés au stylitisme, les mosaïques de sol des édifices jordaniens, ou encore d’édifices chypriotes, renouvelle la perception de l’art de la période.
Cependant ces études d’œuvres, souvent précises et documentées, laissent trop souvent au lecteur l’impression d’une succession de fiches descriptives. L’effet est accentué par l’absence fréquente de transition entre l’évocation d’une œuvre et d’une autre, d’un sujet et d’un autre et par la rapidité du texte. Certaines interprétations, souvent justes, gagneraient à être explicitées, par exemple pour le raisonnement qui permet, à partir de la typologie des reliquaires à huile syriens, de déduire que les ampoules de pèlerinage liées au sanctuaire de Resafa étaient remplies d’huile (p. 176), ou de tirer l’identification du buste figurant sur le caisson central du plafond de Trèves à une impératrice du fait de la représentation d’Apollon sur une bordure sur le plafond de Trèves (p. 182). Des erreurs mineures apparaissent ponctuellement (église Saint-Jean au lieu de Saint-Georges de Madaba, p. 179), et l’absence de reproductions photographiques pour certaines œuvres décrites de façon détaillée (mosaïques de Saint-Démétrios de Nikopolis, patène de Riha par exemple), ou non placées en regard du texte, gênent parfois la lecture. Malgré les éléments de commentaire apportés de manière ponctuelle au fil de l’analyse des œuvres, on regrettera le manque de texte de synthèse par chapitre et surtout sous forme d’une conclusion développée qui permettrait la mise en perspective de la signification globale de ces œuvres dans leur contexte. Néanmoins, l’ouvrage s’imposera désormais comme un point de départ essentiel pour toute personne qui voudrait se familiariser avec l’art des IVe-VIe siècles.
[1] R. Bianchi-Bandinelli, Rome : la fin de l’art antique, Paris, Gallimard, 1970 ; A. Grabar, Le Premier Art Chrétien, Paris, Gallimard, 1967 ; Id., L'Age d'Or de Justinien, Paris, Gallimard, 1966. [2]H. I. Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive ? (IIIe-VIe siècles), Paris, Seuil, 1977 (collection « Points » Histoire, H29).
|
||
|
Éditeurs : Lorenz E. Baumer, Université de Genève ; Jan Blanc, Université de Genève ; Christian Heck, Université Lille III ; François Queyrel, École pratique des Hautes Études, Paris |
||