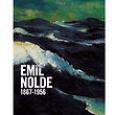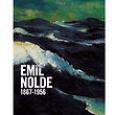 | AA.VV.: Emil Nolde, 1867-1956. Exposition au Grand Palais, Paris, 25 septembre 2008 - 19 janvier 2009. 304 pages, ISBN, 2711854027, 45 euros
(Rmn, Paris 2008)
|
Compte rendu par Florence Rougerie, École pratique des Hautes Études (Paris) Nombre de mots : 2472 mots Publié en ligne le 2009-03-30 Citation: Histara les comptes rendus (ISSN 2100-0700). Lien: http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=514 Lien pour commander ce livre
Cet ouvrage à l’initiative de Sylvain Amic, conservateur en chef au
musée Fabre de Montpellier, et de la Réunion des Musées Nationaux,
vient combler une lacune majeure de la réception française du peintre
Emil Nolde, né Hansen (1867-1957), l’une des figures de proue « de ce
que l’on s’obstine, en France, à nommer Expressionnisme allemand »
comme le note Philippe Dagen (p. 75). Il est couramment associé à
d’autres peintres dans une approche comparatiste : Gauguin et Ensor,
Schmidt-Rottluff et le Brücke, ou encore les Fauves et les
Expressionnistes (1), bien que l’on explore aujourd’hui les pans de son
œuvre de façon plus systématique : Nolde et les mers du Sud, le Japon,
la peinture de paysage, les tableaux religieux, le motif du couple en
ce qui concerne les publications allemandes les plus récentes (2).
Les 90 tableaux et 60 aquarelles, dessins et gravures de l’exposition
sont présentés dans la seconde partie du catalogue : celle-ci reprend
les dix sections du parcours d’exposition, qui ne se veut pas
strictement chronologique et met l’accent sur des thèmes (« La montagne
enchantée », « Un pays » « Bible et légendes », « La mer », ou encore
des notions aussi cruciales que « Welt », « Heimat »), coïncidant
parfois avec des périodes (« Années de combats », « Phantasien » et «
Images non peintes »). Il faut souligner la richesse et la qualité des
reproductions, dont certaines, pleine page, parviennent à rendre
l’aspect monumental de certaines œuvres et d’en apprécier la touche
mouvementée. On est véritablement plongé dans les tableaux Jour de
Moisson (1905) ou Ronde endiablée (1909) (p. 144-145 et p. 158-159).
Les contributions du catalogue présentées dans la première partie,
retracent pour le lecteur divers aspects de son œuvre et de son
parcours ; toutes sont de qualité et fort utiles, très bien traduites
de l’allemand par J. Dorny, J.-L. Müller et A. Virey-Wallon, et
complétées par une riche bibliographie.
Manfred Reuther dans sa contribution « Notre place est ici ! » Emil
Nolde et Seebüll (p. 19-30) explicite l’ancrage du peintre dans une
terre et un paysage qui lui sont vitaux, son attachement à cette
intraduisible Heimat, au point de prendre le nom de son village natal
pour patronyme ; c’est aussi à Seebüll que se trouve aujourd’hui la
Fondation Ada et Emil Nolde. Selon l’auteur, cet enracinement dans «
cette étroite bande de terre prise entre deux mers » (p. 21) entre la
Baltique et la Mer du Nord – que ce soit du côté allemand ou danois,
suite au changement du tracé de la frontière en 1920, consécutif au
Traité de Versailles – lui permet d’« incorporer des mondes lointains,
des éléments disparates et étrangers » empruntés à la grande ville
d’une part, où il recherche, comme Cézanne à Paris, de nouvelles
stimulations visuelles. Il subit d’autre part le tropisme des horizons
lointains, comme Gauguin, cherchant à parcourir tous les stades
d’évolution de l’être humain, de sa nature la plus primitive jusqu’à
son plus haut degré de décadence, incarné par « les gens corrompus de
la ville (…) bas et sales avec leur contraception et leurs avortements
de fœtus jour et nuit » (p. 81).
Sylvain Amic replace les rapports entre Nolde et la France (p. 31-48)
dans le contexte de la réception ambivalente de l’art français en
Allemagne : s’il est exposé à son influence grâce aux expositions des
Sécessions munichoise et berlinoise, ce n’est qu’en 1899 qu’il se rend
à Paris pour suivre une formation à l’académie Julian. A l’occasion de
l’exposition universelle de 1900, il découvre Daumier, Rodin, Millet,
Manet, Degas, Carrière (qui forme alors les futurs fauves Matisse et
Derain), mais se refuse à n’être qu’un épigone. Malgré l’opposition
personnelle de Guillaume II, la présence française devient quasi «
obsédante » en Allemagne : Carl Vinnen en vient à pousser un « cri
d’alarme » (3), auquel Franz Marc répond avec Klimt et d’autres membres
du Cavalier Bleu. Bien qu’il ait pris fait et cause pour ces derniers,
exclus en 1910 de la Sécession par son fondateur, Liebermann, Nolde ne
se prononce pas à cette occasion, parce qu’il prône également un « art
allemand autonome » (p. 110). Il entretient en effet un rapport
ambivalent de rejet et d’admiration mêlés avec ceux qu’il nomme les «
brise-glace » : van Gogh, dont il prise les couleurs et le tempérament
bouillonnant ; Gauguin, dont l’intérêt pour l’art primitif converge
avec le sien et qui l’impressionne plus encore par ses intenses
plages colorées ; Matisse enfin, avec lequel s’exerce une « rivalité
naturelle » et qui comme lui incarne vers 1930 « un art national
réformé » (p. 46).
Peter Vergo dans Emil Nolde : mythe et réalité (p. 49-74) interroge
l’antithèse et le paradoxe comme prisme dans la réception de Nolde, et
en particulier l’image du peintre naïf, inculte et méconnu qu’il a
lui-même construite dans son autobiographie, à la lumière de son
éducation, de ses lectures, de ses interactions avec les milieux d’art.
Cet argument de la naïveté a souvent été utilisé pour le décharger de
ses affiliations nazies. Or ses propos acides teintés d’antisémitisme
lors de son attaque contre la Sécession dirigée à la fois contre
Liebermann et contre le galeriste Cassirer prouvent selon P. Vergo
qu’il était très conscient au contraire du climat politique, car « une
telle emphase s’avérait à peine nécessaire » (p. 58) L’auteur
relativise toutefois son adhésion tardive aux idées nazies sous la
pression de l’environnement politico-social local ; il souligne
également la versatilité de l’attitude des officiels et la variabilité
de leurs critères de sélection. Malgré les faveurs personnelles de
Goebbels, qui se définit encore en 1929 dans son roman Michael comme «
expressionniste jusqu’à l’os », Nolde finit cloué au pilori de l’art
dégénéré : quelque mille œuvres seront en effet exposées en 1937 à
Munich avant d’être montrées dans toute l’Allemagne. Surtout préoccupé
par le sort de ses œuvres, il ne tente de faire valoir l’authenticité
et la germanité de son art que lorsque l’Académie prussienne des Arts
lui demande de démissionner, faisant preuve d’une réaction sensiblement
comparable à celle de Kirchner qui « rêve d’un art sain, beau et
nouveau qui puisse éveiller l’Allemagne. » (p. 70). Lorsqu’il tombe en
1941 sous le coup de l’interdiction d’exercer son art, il se voit
contraint de se réfugier dans son imaginaire, dont il tire ce qu’il
appelle ses quelque mille trois cents « images non-peintes », jetant
ses visions intérieures sur de petits formats, à l’aquarelle. L’auteur
conclut que Nolde fait preuve d’une foi incurable en l’esprit allemand,
espérant la reconnaissance de la « jeunesse allemande avec des yeux qui
voient » (p. 73). Notons que cette figure pleine de paradoxes s’est vue
très largement réhabilitée en Allemagne par le biais d’un ouvrage
devenu un classique de la littérature allemande : Die Deutschstunde de
Siegfried Lenz (1968) (4), qui met en scène le double littéraire de
Nolde, Max Ludwig Nansen.
Philippe Dagen, dans Un voyageur sans illusions (p. 75-85), s’interroge
sur la tonalité du voyage qu’entreprend Nolde en 1913-1914,
accompagnant une mission scientifique en Nouvelle-Guinée, dans le
sillage de Paul Gauguin et de Max Pechstein, mais aussi de Joseph
Conrad, Hermann Hesse et Stefan Zweig. Il s’agit pour l’auteur non de « suggérer une influence improbable » (Amok ne paraît qu’en 1922) mais
d’« indiquer combien le voyage vers l’Asie et le Pacifique séduit
artistes et intellectuels allemands dans les premières années du XXe
siècle » (p. 76) ; les vecteurs matériels de ce magnétisme sont avant
tout les collections ethnographiques publiques des Völkerkundemuseen et
privées comme celle d’Osthaus à Essen. Tout comme chez les autres
peintres du Brücke, de nombreux motifs de masques, de statuettes, de
figures féminines archaïsantes, identifiées ou non, et plus largement
le thème de la célébration de la danse, des corps nus, ainsi que la
technique de la sculpture polychrome sur bois, attestent la curiosité
de Nolde pour l’art primitif dès avant son voyage. Mais comme l’auteur
le montre de façon convaincante, ce tropisme se teinte de regrets d’un
« monde particulier, d’une beauté unique », à jamais perdu, corrompu,
dénaturé : « Si le primitivisme selon Hesse est plaisir du retour aux
origines, celui de Nolde est pénétré par la conscience exaspérée de la
destruction – par l’obsession d’un “trop tard” sans espoir de retour ».
(p. 81). Il démonte un mythe de la vie d’artiste : son « voyage dans
les mers du Sud est ainsi loin d’être (…) le “moment primitif ” que
l’on voudrait croire ». Les scènes de la vie quotidienne qui dépeignent
les indigènes calmes et attentifs, loin du « pittoresque pathétique de
la barbarie », nous tendent le miroir d’une « altérité condamnée » à
disparaître qui ne peut qu’inviter le spectateur d’aujourd’hui à la
réflexion.
Angela Lampe dans En quête d’une esthétique de persuasion (p. 85-95)
interroge le style de Nolde : elle y interprète les caractéristiques de
la monumentalité et la frontalité à la lumière de la rhétorique
classique. Malgré la justesse des observations stylistiques, en
particulier les descriptions des formes colorées et cloisonnées des
tableaux Femmes et Pierrot (1917) ou L’incrédulité de Thomas (Vie du
Christ) (1912) que Carl Einstein critique violemment dans son Art du
XXe siècle (1931), il nous semble que l’argument rhétorique,
reprenant finalement à son compte l’axiome de l’ut pictura poesis, ne
suffit pas pleinement à remporter l’adhésion du lecteur. Il est permis
d’espérer qu’un peintre « réfléchisse à tous les moyens artistiques à
sa disposition (…) pour créer l’effet qu’il souhaite atteindre » (p.
88), ou encore qu’il « pose (…) ses tableaux finis contre le mur
extérieur de son atelier pour pouvoir les contempler aussi bien de très
près que de très loin » (p. 93). Doit-on pour autant en conclure qu’il
veuille « contrôler l’efficacité de sa composition » pour « emporter le
spectateur » ? Le rapprochement avec une forme d’efficace religieuse
nous semble plus pertinent, piste esquissée par la citation de Jean
Epstein sur le visage vu en gros plan : « (…) je le mange. Il est en
moi comme un sacrement. Acuité visuelle maximale » (p. 93.)
Magdalena M. Moeller dans Emil Nolde et le Brücke (p. 95-106) propose
une utile mise au point sur les rapports privilégiés mais non univoques
de Nolde avec les peintres de ce groupe fondé à Dresde en 1905 par
Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel, et Karl
Schmidt-Rottluff, autour de la volonté programmatique de revendiquer «
leur liberté face aux anciennes formes établies » et de reproduire « de
façon immédiate et authentique tout ce qui (…) pousse à créer. » (p.
95) Après une méfiance initiale pour ces jeunes autodidactes, Nolde
cède à la joie d’avoir trouvé des pairs, et répond à l’invitation de
Schmidt-Rottluff en février 1906, admiratif pour les coudées franches
ouvertes par les « tempêtes de couleur » de son aîné. Si Nolde y
investit une énergie certaine pour leur trouver des lieux d’exposition,
des mécènes et des acquéreurs, il s’en distancie pourtant dès 1907,
ayant le sentiment d’être utilisé pour « tirer les marrons du feu » (p.
99). Il trouve en outre leurs productions trop uniformes et inaptes à
porter le nouvel art auquel il aspire, tournant leur « servilité »
envers Van Gogh en dérision (p. 100). Ces liens qu’atteste la proximité
des motifs (masques, nus), des techniques (gravure sur bois) et du
style (voir les portraits croisés de Nolde et de Schmidt-Rottluff
réalisés à Alsen en 1906) lui ont néanmoins permis d’affirmer son
propre style, à la manière d’un « puissant catalyseur » (p. 105).
Mario-Andreas von Lüttichau dans Emil Nolde au Museum Folkwang (p.
107-122), fait le point sur les liens du peintre avec Karl Ernst
Osthaus, un jeune collectionneur éclairé et précurseur qui joua un rôle
d’acquisition, d’exposition et d’intermédiaire considérable dans la vie
de Nolde. Il fonde en 1902 à Hagen le Folkwang Museum, où il expose et
confronte des « chefs d’œuvre de l’art contemporain et des objets
d’arts appliqués européens et extra-européens » (p. 107), qui sont une
source d’inspiration pour les peintres d’avant-garde. Cette entreprise
sans équivalent est étayée puis relayée à sa mort en 1922 par Ernst
Gosebruch au Kunstmuseum d’Essen, avec enthousiasme et audace, les
collections fusionnant en 1929. Outre un soutien financier, par une
politique d’ancrage dans la région et d’acquisition, et malgré des
rapports parfois fluctuants avec Nolde en raison de sa résistance à
l’art français, Osthaus lui offre une visibilité exceptionnelle par des
expositions personnelles régulières, mais ce « vaste panorama » (p.
121) lui vaudra aussi de très larges confiscations par les nazis,
aujourd’hui compensées par une patiente politique de ré-acquisition.
L’auteur éclaire ainsi utilement les conditions de possibilité de la
création.
Dans sa contribution, Andreas Fluck se penche sur le corpus des «
Tableaux bibliques et “Tableaux de légendes” » (p. 123-135), dont il
reconstitue les phases de genèse, décrit les sujets, tirés à la fois de
l’Ancien et du Nouveau Testament, et évoque le destin : nombre d’entre
eux ont été détruits. Il souligne l’attachement particulier de Nolde à
ces œuvres souvent exclues de la vente, et son désappointement devant
le manque de reconnaissance par l’Église, alors qu’elles représentent
pour lui un acte de foi profonde (p. 133). Avec sa réalisation
maîtresse, le cycle de la Vie du Christ en neuf tableaux agencés en
triptyque, Nolde se situe pourtant dans l’héritage direct du retable
d’Issenheim de Matthias Grünewald (1513-1515) dont il reprend certaines
« formules de pathos » pour emprunter au vocabulaire d’Aby Warburg,
dont les recherches lui sont contemporaines. Il éprouve à l’égard des
Juifs une fascination analogue à celle exercée par les populations des
contrées lointaines (5), et représente sous les traits et les costumes
(identifiés ou supposés tels) aussi bien les apôtres que la Vierge, ce
qui suscite des réactions qui le déconcertent et confortent son
sentiment de persécution (p. 127).
Ce catalogue permet de pallier un oubli relatif dans la réception
française, qui peut s’expliquer à la fois par le parcours mouvementé de
Nolde, par son rapport ambivalent à l’art français et par la
spécificité de son art, conditionné par son enracinement culturel à la
fois géographique et historique, l’autre versant de la nature puissante
du nord étant en effet la vie chatoyante de la grande ville, du Moloch
des temps modernes ; ce n’est que l’un des nombreux paradoxes de la
génération expressionniste, à la fois désireuse de retrouver l’harmonie
avec la nature primitive de l’homme (6) et fascinée par la
modernité. Le syncrétisme de Nolde, qui peut surprendre de prime abord
et qu’on retrouve dans la poésie d’Else Lasker-Schüler par exemple, en
fait partie. Mais s’en contenter serait conforter la définition toute
nietzschéenne que Nolde donnait de l’artiste véritable, comme d’un être
: « à la fois simple et cultivé, divin et bestial, un enfant et un
géant, naïf et raffiné, avec du tempérament et rationnel, passionné et
dépourvu de passion, plein d’une vie exubérante et de repos silencieux
» (lettre du 21 août 1901, p. 51), piège déjoué par le portrait nuancé
qu’en font en particulier P. Vergo, Ph. Dagen, et M.-A. von Lüttichau.
La vision de Nolde comme du « grand solitaire de l’Expressionnisme » se
voit corrigée par la mise en perspective de ses stratégies de vente, de
ses échanges avec les artistes de son temps, mécènes, collectionneurs
et critiques, ce qui n’ôte rien au caractère novateur des solutions
plastiques et de l’univers très personnel qu’il propose. Cette
exposition remplit à notre sens les conditions nécessaires au choc de
la rencontre avec son œuvre, remarquablement mise en lumière ; le
présent catalogue fournit de solides outils de compréhension au
spectateur curieux de compléter son expérience, et permet au germaniste
et à l’historien d’art de renouveler son regard sur l’homme, le
personnage et son œuvre.
Notes
(1) James Ensor, Edvard Munch, Emíl Nolde, Regina, Canada, Norman
Mackenzie art gallery, 1980 ; Gravures fauves et expressionnistes,
Paris, Berggruen & Cie, 1989 ; Paul Gauguin, Emil Nolde und die
Kunst der Südsee: Ursprung und Vision, Mayence, H. Schmidt, 1997 ;
Nolde Schmidt-Rottluff und ihre Freunde : die Sammlung Martha und Paul
Rauert Hamburg 1905-1958, Hambourg, Ernst Barlach Haus, 1999.
(2) Emil Nolde : Legende, Vision, Ekstase : die religiösen Bilder,
Cologne, DuMont, 2000 ; Emil Nolde und die Südsee, Munich, Hirmer,
2001; Emil Nolde : BlickKontakte : frühe Porträts, Ostfildern, Hatje
Cantz, 2005; Morgensonnenland : Emil Nolde in Japan, Seebüll, Nolde
Museum, 2005 ; Emil Nolde : Paare, Ostfildern, Hatje Cantz, 2006.
(3) Ein Protest deutscher Künstler, mit Einleitung von Carl Vinnen, Iena, Eugen Diederich, 1911.
(4) Lenz, Siegfried, La leçon d’allemand, trad. B. Kreiss, Paris, Robert Laffont, 2001.
(5) « j’ai envie de peindre cette race étrangère qui vit ici au milieu
de nous, et tout est perçu de travers », lettre d’Emil Nolde à Ada du
15 septembre 1911, p. 127.
(6) Voir Heryun, Kim, Exotische Stilleben Emil Noldes : Versuch einer
Deutung aus seinem Hang zum "Ur", Francfort, Peter Lang, 2001.
|